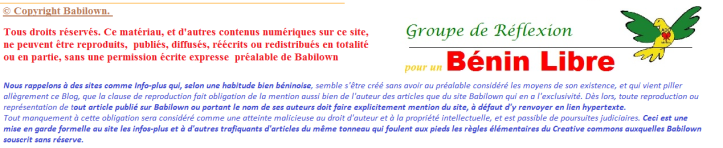Le 7 décembre, au Bénin, la tentative de prise de pouvoir n’a pas seulement échoué : elle s’est dédoublée. À la surprise terrestre des putschistes a répondu une surprise venue du ciel, renversant les rôles et transformant l’opération en une ironie stratégique. Retour sur un épisode où le coup d’État fut lui-même… victime d’un coup d’État.
Si l’on définit le coup d’État comme la mise en jeu soudaine d’une supériorité militaire en vue de s’emparer du pouvoir politique, on peut dire qu’au Bénin, le 7 décembre dernier, il y eut non pas un, mais deux coups d’État en un seul.
Le premier coup d’État fut celui de la surprise militaire orchestrée par la bande à Tigri qui, à l’aube, prit d’assaut les domiciles de certains hauts gradés de l’armée. Dans cette entreprise aussi brutale que confuse, l’épouse de l’un d’eux fut tuée de manière quasi sacrificielle. Les assaillants tentèrent ensuite de s’emparer de la personne du chef de l’État — ou, à défaut, de l’éliminer — avant de se rabattre sur ce qui constitua leur ultime moment de visibilité : la prise d’assaut des studios de la télévision nationale.
Là, ils s’offrirent au pays dans un spectacle à la fois pathétique et dramatique, convoquant simultanément les vieux démons de l’histoire politique nationale et certaines images plus contemporaines des gesticulations militaires sous d’autres latitudes.
Bien entendu, tout au long de ces opérations, ils se heurtèrent à une résistance acharnée des forces loyalistes, malgré l’effet de surprise initial. L’égalité relative des forces en présence, tant sur le plan conventionnel que dans les modes d’affrontement, rendit le combat particulièrement rude. Le risque était réel que la situation ne dégénère et ne finisse par tourner, politiquement et/ou militairement, à l’avantage de ceux qui, dos au mur, avaient fait le choix du désordre et de la violence, dans un pays pourtant foncièrement épris de paix.
Mais l’épisode ne se réduit pas à une simple confrontation entre putschistes et forces loyalistes. L’intervention décisive de la force aérienne, telle qu’elle fut perçue et commentée dans l’opinion, introduit une couche supplémentaire de complexité politique et symbolique. Elle déplace le débat du strict registre de la légalité constitutionnelle vers celui, plus sensible encore, de la souveraineté nationale et des persistances néocoloniales.
C’est alors qu’intervint le second coup d’État.
Celui-ci ne vint pas du sol, mais du ciel. La mise en jeu d’une force aérienne — d’une tout autre dimension technique et militaire — fut totalement imprévisible et imprévue par les assaillants, au point qu’ils auraient presque pu crier à la triche. Cette nouvelle donne, l’entrée en scène de l’aviation, constitua pour les primo-putschistes une surprise aussi inouïe que décisive.
De la même manière qu’ils espéraient instaurer leur pouvoir par l’effet de surprise en renversant les institutions, l’effet de surprise de la contre-attaque des forces du régime se transforma pour eux en un coup d’État dans le coup d’État.
Il n’est pas jusqu’au fait même de l’intervention de la force aérienne — présentée par certains comme venue du Nigeria, sur instigation française et sous le faux drapeau de la CEDEAO, mais que d’autres soupçonnent d’avoir été directement produite par la France elle-même — qui n’alimente cette impression de déloyauté. Le rôle de la France dans cette affaire demeure, au mieux, d’une ambiguïté troublante ; au pire, il illustre cette impénitence néocoloniale qui consiste à intervenir sans jamais apparaître, à peser sans jamais assumer.
Cette donnée nouvelle, la projection d’une puissance aérienne extérieure ou perçue comme telle, ne relève pas seulement d’un avantage militaire décisif ; elle pose frontalement la question de la souveraineté nationale. À ce titre, elle introduit une rupture qualitative dans la nature même du conflit. Le premier coup d’État constitue une violence armée dirigée contre l’État de droit et la Constitution ; le second, lui, porte atteinte à un principe tout aussi fondamental : celui de l’autonomie politique et stratégique de la nation.
Pour le dire autrement, il ne s’agit plus seulement d’un affrontement interne, aussi illégitime soit-il, mais d’une situation où l’irruption d’un tiers change la nature du jeu. Quand un couple est en train de se battre, et que le voisin — au demeurant un amant caché — intervient aux côtés de la femme pour frapper l’homme, on ne peut plus parler de simple conflit conjugal. Le rapport devient autre, la scène se reconfigure, et la responsabilité se déplace.
Dans les deux cas, la logique demeure celle de l’irruption soudaine et non loyale de la force. Il n’est évidemment pas loyal qu’une fraction des forces armées cherche à renverser l’ordre établi par les armes. Mais il n’était pas davantage loyal — ni même pensable, du point de vue des insurgés — d’utiliser des moyens de guerre aérienne contre des forces terrestres. Dans leur imaginaire, tout devait se régler au corps à corps, sur le plancher des vaches, dans une confrontation virile et strictement terrestre.
L’irruption de la puissance aérienne, qui les ramena brutalement à leur dimension lilliputienne, fut pour eux à la fois un choc stratégique et le point final de leur aventure.
Tel est pris qui croyait prendre.
Adenifuja Bolaji