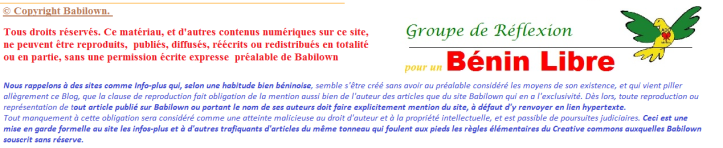Le 23 juillet 2025, le gouvernement béninois annonçait en grande pompe la nomination de Tonya Lewis Lee et de Spike Lee comme « Ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis ». Un geste hautement symbolique, présenté comme un jalon stratégique dans le rapprochement entre le Bénin et ses diasporas. L’émotion, le clinquant et l’adhésion automatique de l’opinion semblaient aller de soi. Et pourtant…
Au risque de détonner dans le chœur consensuel, une question s’impose : de quoi est-on vraiment en train de parler ? S’agit-il d’un acte structurant, enraciné dans un projet politique cohérent ? Ou plutôt d’une opération de communication bien ficelée, destinée à redorer une image, à flatter l’extérieur ou à surfer sur les vagues molles du panafricanisme sentimental ?
Un pays — surtout lorsqu’il se dit en quête de renaissance — ne se gouverne pas à coups de mondanités sur papier glacé. Ce ne sont pas les rubriques « people » de la mémoire qui redressent les nations, ni les selfies aux côtés de stars hollywoodiennes, fussent-elles engagées et sincères dans leur démarche. La mémoire est une chose sérieuse. Et la diaspora, un enjeu trop complexe pour être réduite à un gadget diplomatique ou une opération marketing à l’adresse des Afro-descendants en quête de racines.
Symboles creux contre symboles d’architecture
En l’occurrence, donner du sens à notre lien avec l’empire du Bénin — le véritable État d’Edo, aujourd’hui au Nigeria — serait un acte symbolique autrement plus dense que la nomination de stars américaines. Ce lien-là ne relève ni du fétichisme mémoriel ni du folklore international, mais d’un enjeu historique, culturel et identitaire majeur : renouer avec la trajectoire continentale de notre nom, de notre héritage, de notre inscription dans l’histoire africaine.
Car il faut le dire clairement : il y a symbole et symbole. Il y a le symbolisme structurant, qui aide à penser, à s’ancrer, à se projeter collectivement dans le temps. Et puis, il y a le symbolisme prêt-à-porter, à usage touristique ou diplomatique, fait de storytelling creux, de gestes spectaculaires, de mémoire calibrée pour les réseaux sociaux ou les brochures de ministère.
Ce dernier type de symbolisme est souvent plus séduisant, plus maniable — mais aussi plus vide.
Notre pays en est un parfait exemple. Le Bénin s’appelait Dahomey jusqu’en 1975. Ce nom, lié à un royaume puissant mais localisé, portait aussi une mémoire douloureuse liée à la traite. La Révolution a voulu rompre avec cette charge historique, et a choisi un nom plus neutre, plus large, plus « panafricain » : République Populaire du Bénin.
Mais ce nom ne sort pas de nulle part. Il fait référence à l’ancien empire du Bénin, aujourd’hui situé dans l’État d’Edo au Nigeria, avec Bénin City pour capitale. Un empire prestigieux, redouté, politiquement centralisé, et d’une richesse artistique sans équivalent en Afrique précoloniale, comme en témoignent les célèbres bronzes du Bénin.
Or, malgré ce nom, aucun lien réel n’a été institutionnalisé avec cet État frère. La majorité des Béninois ignorent totalement cette origine, et la vie nationale s’en soucie à peine. Ce nom, que nous portons chaque jour, est devenu une étiquette sans contenu, un symbole flottant, vidé de son architecture historique.
Et pourtant, ce lien avec l’empire du Bénin pourrait nourrir une politique culturelle et mémorielle solide, transfrontalière, panafricaine au sens profond du terme. Ce serait un symbole signifiant, structurant, restitué dans toute sa profondeur géopolitique et civilisationnelle. Mais c’est un symbole qui ne s’affiche pas facilement en couverture. Il demande travail, courage, continuité.
Il ne s’agit pas d’opposer brutalement les démarches : dialoguer avec la diaspora est une chose louable. Mais encore faut-il savoir distinguer les symboles creux des symboles d’architecture. On n’écrit pas une politique de mémoire à coups de paillettes et de storytelling. On la construit comme une maison solide, pierre après pierre, en tenant compte des fondations.
Le tropisme de la mémoire importée
Si nous étions sérieux — vraiment sérieux — ce n’est pas cette obsession de la diaspora afro-américaine qui nous habiterait en priorité, mais la redécouverte active de nos propres histoires, de nos propres lignées, de nos propres ruptures. En d’autres termes : la mise en valeur de notre relation avec l’État d’Edo, dont nous avons emprunté le nom — le Bénin — sans jamais véritablement renouer avec l’héritage historique et politique qu’il implique.
Ce lien concret, géographiquement proche, historiquement fécond, politiquement porteur, ne figure nulle part dans nos priorités diplomatiques ou culturelles. Trop proche, trop banal, trop africain peut-être… et surtout, pas assez vendeur aux yeux d’un pouvoir toujours en quête de reconnaissance extérieure.
Une mémoire instrumentalisée
La nomination des Lee ressemble à s’y méprendre à une instrumentalisation — bien intentionnée, certes, mais instrumentale tout de même — de la mémoire. Une manière de « cocher la case » diaspora, de montrer au monde que nous aussi, nous savons entretenir notre récit post-esclavagiste, nous aussi, nous savons faire rêver les enfants perdus de l’Afrique. Une caution de gauche caviar qui cache mal une insertion droitière voire néocoloniale idéologiquement affirmée et bien assumée
Mais le rêve ne suffit pas. Il faut des ponts solides, pas des passerelles éphémères. Il faut des politiques de vérité, pas seulement des politiques d’image. Il faut oser dire que le lien entre l’Afrique et sa diaspora ne se fabrique pas à partir d’une plateforme numérique ni d’une cérémonie ministérielle, mais dans un travail de fond, sur la durée, dans l’échange, l’engagement et le réciproque apprentissage.
Le cadet de nos soucis
Mais voilà : tout cela est le cadet de nos soucis. Nous préférons les apparitions sur fond de drapeau, les grandes annonces creuses, les inaugurations de plateformes numériques et les accolades présidentielles filmées en 4K. Et pendant ce temps, les véritables défis de la mémoire — la réconciliation avec nos propres violences historiques, la remise en question de nos récits nationaux, l’ouverture à des histoires partagées africaines — sont reportés à plus tard. À jamais, peut-être.
Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas de dénigrer Spike Lee ni de moquer la sincérité d’un dialogue avec la diaspora. Mais de rappeler que la reconstruction identitaire ne peut être laissée aux seuls soins des figures médiatiques et des narrations formatées. Elle exige un courage politique, une honnêteté historique, et une capacité à regarder nos propres ombres — pas seulement à chercher notre reflet dans les yeux émus de ceux qui nous regardent depuis Harlem ou Atlanta.
En résumé :
Oui, il faut des symboles. Mais des symboles vrais, porteurs de mémoire active, de projets profonds, d’enracinement.
Le Bénin mérite mieux que des effets d’annonce. Il mérite des actes. Et un peu moins de storytelling.
Adenifuja Bolaji & Brian Armstrong