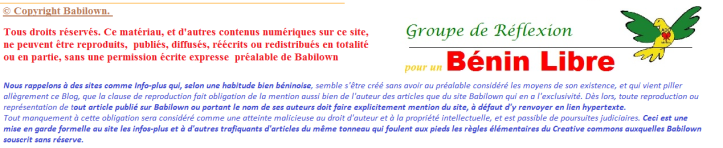En cherchant sur le site officiel du gouvernement béninois ce qu’il disait de nos langues, je n’ai rien trouvé. Pas une ligne, pas une rubrique consacrée à ce qui constitue pourtant le cœur de notre identité culturelle. Le site abonde en informations pratiques et en pages sur le coronavirus, mais reste muet sur nos langues nationales. C’est là un signe clair : le patrimoine linguistique du Bénin est encore relégué au second plan, réduit à une présence décorative à travers quelques statues commémoratives, mais absent de la réflexion politique et institutionnelle.

Sur le site du consulat du Bénin en France, une section intitulée « Langue » existe bien, mais elle se consacre presque exclusivement au français, présenté comme langue officielle et condition d’accès à la citoyenneté, à la justice et à l’éducation. Les langues nationales, en revanche, n’y apparaissent que comme un simple inventaire, évoquées de manière superficielle, sans véritable reconnaissance ni statut. On y rappelle que seul le français est admis au Parlement, dans les tribunaux et dans les documents administratifs, et que la loi électorale exige lui aussi sa maîtrise. Autrement dit, des millions de Béninois qui ne parlent pas ou peu le français sont, de fait, exclus de la pleine citoyenneté. Il est vrai que le consul étant un Français, sa présentation semble davantage obsédée par la défense et l’illustration de sa langue maternelle que par la volonté de rendre justice aux langues du pays dont il est le représentant en France.
Pourtant, cette invisibilisation contraste avec le travail mené par les linguistes béninois eux-mêmes. Le professeur Albert Akoha, linguiste et président du comité des linguistes, rappelle que l’alphabétisation au Bénin a une histoire et que beaucoup de progrès ont été réalisés dans le choix des langues. Selon lui, les linguistes ont proposé et adopté six langues béninoises officielles, appelées « langues d’intercommunication », en s’efforçant de mettre en place un alphabet unifié pour chacune. Dans le nord du pays, ce sont le dendi, le batonù et le ditamari avec leurs affiliés ; dans le sud, le fon, le yoruba et l’aja. Ces choix visent à donner aux langues nationales un statut officiel, à structurer l’espace linguistique et à faciliter la communication interethnique.

À la lecture de cette démarche, certaines limites apparaissent cependant. La division du pays en deux grandes zones – nord et sud – ne suit ni les découpages administratifs ni les réalités démographiques. Le méridion, par exemple, est de loin plus plus peuplé que le septentrion, mais les linguistes ont imposé un équilibre artificiel de trois langues dans chaque partie. Cette logique de parité, sans rapport avec les dynamiques réelles de la population ou de l’usage linguistique, et propre à la mentalité sociopolitique du Bénin conduit à des choix forcés.
Ainsi, certaines langues ont été privilégiées au détriment de leurs dialectes ou variétés. Le fon et le yoruba, par exemple, ont été retenus comme langues représentatives de leur groupe, alors que d’autres variantes – nagot dans le groupe éde, aïzo et goun dans le groupe gbè – auraient posé de délicates questions d’officialisation. Dans le sud, la contrainte de « trois langues » a conduit à inclure l’aja, langue source dont dérive le fon, choix sans doute plus symbolique et politique que démographique ou fonctionnel.

Cette tension entre reconnaissance et simplification révèle le dilemme du Bénin : d’un côté, un État qui continue de marginaliser les langues nationales, renforçant la suprématie du français ; de l’autre, des linguistes qui s’efforcent de les structurer et de les valoriser, mais qui se trouvent pris dans des logiques artificielles et des compromis symboliques. Entre invisibilisation institutionnelle et reconnaissance partielle, nos langues demeurent traitées comme des marges, alors qu’elles devraient être au cœur d’une véritable politique culturelle et éducative.
Le contraste est saisissant : d’un côté, un discours officiel qui fait grand bruit autour du vodun, érigé en emblème identitaire et en produit d’appel touristique ; de l’autre, un silence persistant et un mépris à peine voilé envers les langues dans lesquelles s’expriment et se transmettent ces savoirs. La contradiction est flagrante : comment exalter le vodun tout en marginalisant les langues qui en constituent l’âme vivante ? À ce rythme, et dans le sillage de l’idéologie linguistique héritée de la colonisation – relayée parfois jusqu’au sein même de notre représentation consulaire en France – on finira peut-être par exiger des vodun qu’ils s’expriment en français. Cela ferait sans doute la joie des touristes, mais au prix d’une réduction dramatique : le vodun transformé en folklore pour visiteurs, simple auxiliaire d’un marché culturel mondialisé.
Or, sans les langues, il n’y a pas de transmission authentique de la culture nationale ; sans elles, il n’y a ni mémoire digne de ce nom, ni citoyenneté pleinement inclusive. L’avenir de notre identité collective dépend de la place que nous saurons donner à nos langues dans l’école, dans les médias, dans l’espace public – bref, au cœur même de la vie nationale.
Ahandeci Berlioz