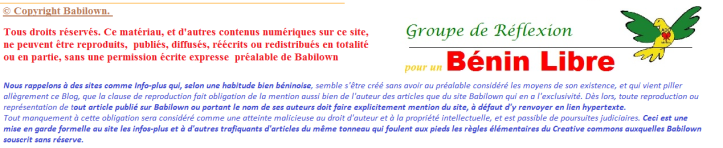Sous le régime de la rupture, le peuple béninois a été doublement relégué : appauvri dans son quotidien et neutralisé dans sa capacité politique. Entre vitrification touristique et verrouillage institutionnel, deux dynamiques complémentaires se sont mises en place : l’indigence sociale et l’exclusion démocratique. Deux mamelles d’un même mépris, méthodique et assumé.
Les Deux Mamelles du Mépris du Peuple par le Régime de la Rupture
Contrairement à son prédécesseur — et cela pour le meilleur comme pour le pire — Patrice Talon ne se distingue guère par un sens aigu du service public. Certes, Yayi Boni entretenait un rapport plus démonstratif avec les populations ; mais ni son paternalisme affiché ni la froideur technocratique du régime actuel ne constituent des absolus moraux. La vérité se situe ailleurs : tous deux, chacun à sa manière, ont intégré un cadre mental où les intérêts français ne sont pas seulement prioritaires, mais considérés comme structurellement opposés à ceux du Bénin.
Dans cette logique, défendre les aspirations profondes du pays apparaît presque comme une transgression. Les gouvernants, prisonniers d’un réflexe néocolonial intériorisé, se comportent comme si toute affirmation souveraine du Bénin risquait de compromettre l’équilibre d’un pacte tacite où l’ancienne métropole demeure la référence ultime. Cette perception faussée explique l’espèce d’aliénation obtuse qui s’impose au pays depuis des décennies, une aliénation dont le tourisme n’est que le dérivatif économique : une manière d’exister aux yeux d’autrui faute d’oser se définir par soi-même.
On l’a vu chez Yayi Boni dans sa posture ostentatoire de « Je suis Charlie », mimant les émotions de la France au lieu de porter celles de son propre peuple. On l’a vu chez Talon dans son alignement quasi pavlovien sur les priorités géopolitiques françaises — notamment dans le dossier nigérien — alignement qui a semblé primer sur toute défense autonome des intérêts béninois.
La soumission ne se limite cependant ni à la diplomatie ni à l’économie : elle s’enracine plus profondément, dans l’ordre intellectuel et symbolique. Car le refus persistant de repenser l’éducation en dehors du moule néocolonial prolonge l’infériorité intériorisée du pays. Plutôt que d’entreprendre une réforme qui libérerait symboliquement les esprits — en permettant aux enfants d’apprendre, de réfléchir et d’écrire dans leur langue — on maintient les générations entières dans des messes francophones où l’on récite des savoirs importés et où l’on demande, presque rituellement, l’absolution culturelle de la France. Le peuple demeure ainsi soumis à un système scolaire qui le coupe de lui-même avant de le couper du monde.
Cette soumission symbolique constitue l’une des manifestations les plus insidieuses du mépris : une nation que l’on détourne de sa propre voix pour qu’elle continue à parler avec celle d’un autre.
Première mamelle : l’indigence sociale comme politique d’État
Le rapport de Talon au peuple ne souffre aucune ambiguïté. Son régime s’est ouvert sur des déguerpissements brutaux, un vaste « dégage » adressé aux populations occupant des espaces devenus soudain convoités pour une économie touristique extravertie. Le fossé s’est ensuite élargi : taxes en cascade, hausse draconienne d’impôts, flambée du coût de la vie, précarité généralisée.
Pendant que des pans entiers de la fonction publique étaient sacrifiés — notamment dans l’enseignement, pourtant pilier du développement — des salaires indécents étaient maintenus pour les instituteurs et professeurs, tandis que de nouvelles recrues militaires bénéficiaient de rémunérations largement supérieures. Rien n’illustre mieux la hiérarchie silencieuse des priorités : on investissait plus dans la force que dans le savoir, plus dans la dissuasion que dans l’avenir.
Dans cette même logique tournée vers l’extérieur, le pouvoir s’est lancé dans la promotion d’un tourisme mémoriel clinquant : festivals « brésilianisés », opérations de relooking patrimonial, et même incitation adressée aux descendants d’esclaves à acquérir la nationalité béninoise. Au lieu de s’attaquer d’abord à la détresse quotidienne des citoyens, le régime préférait séduire un public international dont le regard comptait davantage que la souffrance de ceux d’ici. Tout se passait comme si l’attention dédiée aux visiteurs potentiels excédait celle réservée à la population réelle : une politique culturelle et identitaire conçue pour autrui plutôt que pour les Béninois eux-mêmes.
Puis, pendant que routes, ponts, monuments et hôpitaux trop chics pour la population surgissaient de terre pour donner au pays une allure de vitrine tropicale, le peuple s’enfonçait dans la faim et la précarité.
C’est ainsi que le Bénin s’est mué en une dame coquette, sommée de se maquiller pour séduire les visiteurs, tandis que ses propres enfants vivaient dans la privation quotidienne. L’apparence devait briller, quitte à sacrifier ce qui fait la substance d’une nation.
Cette logique d’embellissement vitrifié constitue la première mamelle du mépris : la fabrication méthodique de l’indigence sociale.
Seconde mamelle : la mise hors-jeu politique sous couvert de rationalisation
La marginalisation du peuple ne s’est pas limitée à l’économie sociale ; elle s’est doublée d’une reconfiguration politique profonde. Le pouvoir a patiemment érigé une architecture institutionnelle monolithique, présentée comme une rationalisation de la vie politique. En réalité, un monopartisme feutré s’est installé, sous couvert de modernisation.
La révision constitutionnelle a marqué l’apogée de cette dynamique. Imposée sans consultation populaire, elle a dissimulé sous des promesses de stabilité des mutations majeures : création d’un Sénat non électif, prolongation du mandat des élus à sept ans, vote effectué par une Assemblée en fin de course.
Comment des représentants, même supposés légitimes, peuvent-ils modifier ainsi la loi fondamentale sans conditionner l’opération à une réélection préalable ? Et surtout : comment écarter le peuple d’une mutation aussi cruciale sans recourir au référendum, seule expression authentique de sa souveraineté ?
Les manœuvres qui ont, par ailleurs, éliminé quasi mécaniquement toute opposition crédible pour les prochaines élections ont confirmé la confiscation politique en cours. Après l’indigence sociale, voici l’expropriation civique.
Entre appauvrissement programmé et verrouillage institutionnel, les deux mamelles du mépris nourrissent un même projet : gouverner sans le peuple, tout en parlant ostensiblement en son nom. À cette mécanique matérielle s’ajoute un autre ressort, plus profond encore : la neutralisation intellectuelle et symbolique d’un pays sommé d’emprunter la voix d’autrui plutôt que d’assumer la sienne. Lorsque les intérêts nationaux sont perçus comme suspects, voire incompatibles avec ceux de la tutelle étrangère, lorsque l’école perpétue la dépendance au lieu d’émanciper, lorsque le tourisme devient l’horizon de sens d’un État qui n’ose plus imaginer son propre avenir, le mépris cesse d’être un simple travers politique : il devient une structure.
Dans un système où l’apparence marchandisée prime sur la vie réelle, où la souveraineté s’efface sous le réflexe d’obéissance, et où les enfants eux-mêmes sont dépossédés de leur langue pour mieux être dépossédés de leur monde, la rupture entre dirigeants et dirigés n’a jamais semblé aussi achevée… ni aussi préoccupante. C’est tout un pays que l’on force à briller pour les autres alors qu’on lui refuse la lumière pour lui-même..
Adenifuja Bolaji