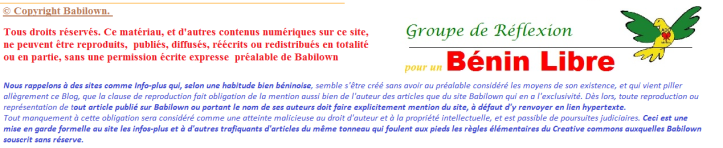Faut-il protéger un homme, ou sauver une nation ? À travers la condamnation de Nicolas Sarkozy, la France se trouve face à un choix tragique : préserver l’image d’un ancien président au nom de la fidélité, ou assumer la vérité au risque d’exposer au grand jour la honte d’un pouvoir corrompu. Entre loyauté à une figure d’autorité et exigence de justice, ce procès soulève une question plus profonde : une République peut-elle regarder l’avenir en face sans trahir sa mémoire, ni renier ses principes ?.
Une nation soucieuse de son avenir ne peut se permettre d’aborder les faits politiques sous le seul prisme passionnel du moment. Elle doit savoir regarder au-delà de l’écume des jours, prendre du recul, et penser en termes de continuité historique, de responsabilité collective et de transmission. La récente condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison ferme pour corruption et financement illégal de campagne, dans le cadre de l’affaire libyenne, a provoqué une onde de choc. Pas seulement dans les cercles politiques — mais dans tout le pays. Et ce tumulte dit beaucoup plus qu’il n’y paraît.
On retrouve, sans surprise, une polarisation familière : la gauche salue une décision de justice qu’elle estime salutaire ; la droite s’indigne, dénonce une chasse à l’homme, fustige un supposé « gouvernement des juges ». Mais ce clivage, désormais routinier, n’est pas le plus troublant.
Ce qui interroge plus profondément, c’est le comportement d’une partie du monde médiatique et intellectuel. Certains de ceux qui, pendant des décennies, ont porté le masque de l’objectivité, de la neutralité, de la retenue, se sont précipités pour défendre l’ancien président avec une ferveur à peine croyable. Ils dénoncent une justice « politisée », une vengeance judiciaire, une atteinte à l’autorité suprême de l’État.
En réalité, ce dévoilement soudain dit tout du faux-semblant de leur neutralité passée, et révèle au grand jour la collusion d’intérêts qui soude une élite politique, médiatique et économique, longtemps habituée à évoluer en circuit fermé. L’affaire Sarkozy ne met pas seulement en cause un homme : elle ébranle un ordre établi. Celui de ceux qui pensaient que les puissants ne seraient jamais jugés comme les autres.
Mais une nation ne se maintient pas debout en protégeant ses puissants déchus. Elle se construit — ou se reconstruit — en assurant à tous que nul n’est au-dessus des lois. Elle se protège non pas par l’oubli, mais par la clarté. Et elle prépare son avenir non par la loyauté aux figures déchues du passé, mais par l’exigence de vérité.
Il faut bien le dire : Nicolas Sarkozy n’est pas un président comme les autres. Il est aussi le nom de violences politiques et diplomatiques inouïes. L’intervention militaire en Libye, menée sous son autorité, a laissé un pays dévasté, des milliers de morts, et une région entière plongée dans le chaos. Ce choix, fait au nom des droits de l’homme mais motivé aussi par des intérêts opaques, a réintroduit l’esclavage, déstabilisé durablement le Sahel, et ouvert la voie à des réseaux mafieux transnationaux. Tout cela, avec un cynisme brutal et une légèreté stratégique confondante.
Mais il serait simpliste de faire de Sarkozy le seul visage de cette brutalité. Car la France n’en est pas à son premier forfait international. Elle porte, dans sa mémoire longue, une histoire lourde de colonisation, de domination, d’esclavage, et de violences raciales systémiques. Des siècles de brutalité institutionnalisée ont forgé un rapport profondément déséquilibré à l’Autre, à l’Afrique, au pouvoir, à l’impunité. Et l’on retrouve, dans certaines décisions récentes, les échos amers de ce passé jamais vraiment assumé.
Cela dit, l’affaire du financement libyen dépasse la simple logique de continuité historique. Elle touche au cœur même de la République : l’intégrité de son processus démocratique. Ici, il ne s’agit pas d’un débat idéologique ou d’un désaccord stratégique. Il s’agit d’un président de la République accusé d’avoir bradé l’honneur de la nation pour accéder au pouvoir, en sollicitant et acceptant des millions d’euros d’un dictateur.
La justice a parlé : cinq ans de prison, dont trois ferme. C’est un séisme symbolique. Et c’est une bonne nouvelle. Car dans cette affaire, ce n’est pas seulement le passé qui est en jeu — c’est l’avenir qui est en cause. Un avenir que la République ne pourra construire que si elle est capable de regarder ses fautes en face, de briser les chaînes de l’impunité, et de faire primer l’intérêt général sur les fidélités personnelles ou de classe.
Ceux qui s’agitent aujourd’hui pour défendre Sarkozy, qui hurlent à l’injustice depuis les salons feutrés où ils ont toujours prospéré, devraient s’interroger. Ce qu’ils défendent, ce n’est pas la justice : c’est leur monde. Un monde qui vacille parce qu’il découvre qu’il peut, lui aussi, être jugé.
Et il est bon, il est sain, il est vital que cela vacille.
Conclusion : une exigence de justice pour ne pas sombrer
L’affaire Sarkozy ne doit pas être vue comme un simple épisode judiciaire ou politique. Elle est un miroir tendu à la République, un test de sa maturité. La France peut-elle vraiment être un État de droit, ou restera-t-elle une monarchie républicaine où certains seraient éternellement intouchables ? La réponse donnée par la justice est claire. Il appartient désormais au peuple, aux institutions, et à l’Histoire de s’en souvenir.
Abdel Benouzi