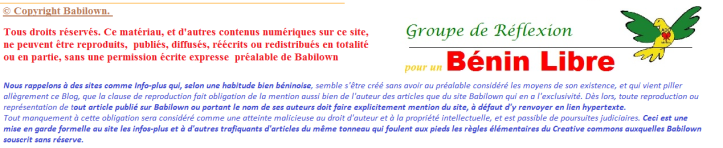Au lendemain des indépendances africaines, le discours panafricaniste domine l’espace politique et intellectuel. Il promet une Afrique réconciliée avec elle-même, libérée des divisions héritées de la colonisation, unie par une solidarité naturelle entre peuples frères. Pourtant, derrière cette rhétorique euphorique, la réalité sociale et politique est bien plus rude.
L’histoire des Dahoméens en Afrique de l’Ouest à la fin des années 1950 et au début des années 1960 en offre une illustration saisissante.
Présents dans de nombreux pays voisins, souvent instruits et employés dans l’administration ou le commerce, les Dahoméens deviennent rapidement des figures ambiguës : indispensables mais contestées, intégrées mais rejetées. Dès 1967, la politologue Suzanne Bonzon résumait cette situation par une formule saisissante :
« Le problème dahoméen tient tout entier dans cette contradiction : une minorité expatriée trop scolarisée, un pays faible et sans ressources. »
Cette contradiction est au cœur des violences, expulsions et humiliations subies par les Dahoméens au sortir de la colonisation.

Une diaspora africaine avant l’heure
Contrairement à une idée répandue, la présence des Dahoméens en Afrique de l’Ouest ne commence pas avec les indépendances. Elle est ancienne, parfois vieille de plusieurs décennies. Sous la colonisation, les autorités françaises avaient largement recours aux Dahoméens pour occuper des fonctions intermédiaires : commis, secrétaires, clercs, instituteurs. Leur niveau de scolarisation relativement élevé, hérité d’une politique éducative précoce au Dahomey, en faisait une main-d’œuvre mobile et recherchée.
En Côte-d’Ivoire, dès 1954, près d’un tiers des commis de la fonction publique sont des non-originaires, majoritairement dahoméens. Dans les villes comme Abidjan ou Niamey, ils incarnent une forme de réussite sociale accessible par l’école, mais inaccessible à beaucoup de jeunes locaux.
Cette situation, longtemps tolérée, devient explosive lorsque l’indépendance politique ne s’accompagne pas d’une amélioration économique.

Côte-d’Ivoire 1958 : quand l’indépendance engendre l’exclusion
À la fin des années 1950, la Côte-d’Ivoire connaît un ralentissement économique. Le « boom » des années précédentes s’essouffle, le chômage apparaît, notamment chez les jeunes urbains scolarisés. Dans ce contexte, les Dahoméens deviennent des boucs émissaires idéaux.
Les frustrations économiques se transforment en ressentiment nationaliste. Beaucoup d’Ivoiriens ont le sentiment que l’indépendance profite d’abord à des étrangers africains plutôt qu’à eux-mêmes. Les emplois administratifs, perçus comme des symboles de promotion sociale, cristallisent les tensions.
En octobre 1958, à la suite d’un incident mineur, la situation dégénère. Pendant trois jours, Abidjan est le théâtre de véritables chasses aux étrangers. Environ vingt mille personnes — principalement des Dahoméens — se réfugient dans le vieux port. L’État ivoirien perd le contrôle de la situation. Les appels au calme du président Houphouët-Boigny restent sans effet.

Ces violences ne débouchent pas sur une rupture diplomatique avec le Dahomey, mais elles laissent une trace durable dans les mémoires. Elles montrent surtout que l’indépendance n’a pas effacé les logiques d’exclusion : elle les a parfois renforcées.
Des expulsions en chaîne dans l’Afrique francophone
La Côte-d’Ivoire n’est pas un cas isolé. Dans les années qui suivent, les Dahoméens sont expulsés ou marginalisés dans plusieurs pays d’Afrique francophone.
Au Sénégal, près de deux mille Dahoméens sont renvoyés alors qu’ils occupaient des postes administratifs hérités de l’ancienne A.O.F. Le Gabon et le Congo-Brazzaville adoptent des mesures similaires quelques années plus tard.
Ces expulsions suivent souvent le même schéma : face à des tensions économiques ou politiques internes, les gouvernements nouvellement indépendants désignent des étrangers africains comme responsables implicites des difficultés nationales. La solidarité panafricaine cède alors la place à un nationalisme défensif, parfois brutal.
Comme le souligne Suzanne Bonzon, ces conflits sont récents, alors même que la migration dahoméenne est ancienne :
« L’émigration des Dahoméens est relativement ancienne (…) alors que la situation conflictuelle est récente. »
Autrement dit, ce n’est pas la cohabitation qui pose problème, mais la manière dont les États postcoloniaux redéfinissent l’appartenance nationale.
Le conflit nigéro-dahoméen : panafricanisme sous tension
Le cas du Niger illustre une autre facette de ces contradictions. En 1963, après la révolution qui renverse le président dahoméen Hubert Maga, les relations entre le Dahomey et le Niger se tendent. Un vieux différend frontalier autour de l’île de Lété refait surface, tandis que la communauté dahoméenne de Niamey est perçue comme une menace potentielle pour la stabilité du régime nigérien.

En décembre 1963, le gouvernement du Niger expulse les fonctionnaires dahoméens, entraînant le départ d’environ seize mille personnes. La décision est populaire au Niger, mais provoque une crise majeure au Dahomey. Des troupes sont envoyées à la frontière, et le Dahomey bloque temporairement les marchandises nigériennes transitant par le port de Cotonou.
Le conflit ne dégénère pas en guerre ouverte, mais il révèle la fragilité des mécanismes panafricains. Ni le Conseil de l’Entente ni l’Organisation de l’unité africaine ne parviennent immédiatement à apaiser durablement les tensions.
L’impuissance des États et l’angle mort du panafricanisme
Pourquoi le Dahomey, malgré les injustices subies par ses ressortissants, agit-il si peu efficacement ? La réponse tient à sa faiblesse structurelle. Suzanne Bonzon résume cruellement cette impasse :
« Trop proche pour s’en désintéresser, trop faible pour les protéger, trop petit pour les réintégrer. »
Cette formule met à nu l’un des grands non-dits du panafricanisme : l’unité proclamée ne suffit pas lorsque les États manquent de moyens, de stabilité et de poids diplomatique. Les idéaux d’unité africaine se heurtent aux réalités des frontières, des économies inégales et des peurs identitaires.
Les Dahoméens paient ainsi le prix d’une double illusion : celle d’une indépendance censée garantir l’égalité entre Africains, et celle d’un panafricanisme incapable de protéger concrètement les individus.
Conclusion : regarder l’histoire sans fard
L’histoire des Dahoméens au sortir de la colonisation invite à une relecture lucide de l’Afrique postcoloniale. Elle ne disqualifie pas le panafricanisme en tant qu’horizon politique, mais elle en révèle les failles, les silences et les contradictions. Elle montre surtout que l’unité africaine ne saurait être une simple proclamation idéologique : elle doit se traduire par des mécanismes concrets de protection, de solidarité et de reconnaissance, tant sur le plan politique que social et juridique.
À défaut, les indépendances produisent ce qu’elles prétendaient abolir : des frontières mentales renforcées, des exclusions nouvelles entre Africains, et des solidarités fragiles, souvent conditionnées par les rapports de force économiques ou diplomatiques. Le sort réservé aux Dahoméens dans plusieurs pays voisins rappelle que le nationalisme postcolonial, lorsqu’il se construit dans l’urgence et la peur, peut devenir une force de fragmentation aussi puissante que la domination coloniale elle-même.

C’est à la lumière de cette histoire qu’il convient d’observer les tentatives contemporaines de recomposition politique en Afrique, notamment dans le Sahel. La naissance de l’Alliance des États du Sahel (AES), portée par une volonté affirmée de rupture avec les tutelles néocoloniales et par l’ambition d’une confédération régionale, marque un retour explicite du projet d’unité africaine sur des bases souverainistes et anticoloniales. Elle témoigne d’un désir de reprendre en main les leviers politiques, sécuritaires et économiques, en dehors des cadres hérités de la période coloniale.
Mais l’histoire invite à la prudence. L’échec partiel du panafricanisme des années 1960 ne résidait pas seulement dans les ingérences extérieures, mais aussi dans l’incapacité des États africains à dépasser les réflexes d’exclusion, de suspicion et de concurrence interne. Si l’AES veut éviter de reproduire ces impasses, elle devra tirer les leçons du passé : l’unité ne peut se construire contre d’autres Africains, ni au prix de nouvelles marginalisations internes. Elle suppose une citoyenneté inclusive, une circulation protégée des personnes, et une solidarité effective entre peuples, et pas seulement entre régimes.
Ainsi, l’histoire des Dahoméens ne relève pas d’un simple épisode du passé. Elle agit comme un miroir tendu au présent. Elle rappelle que toute ambition confédérale ou panafricaine ne se mesure pas à la force des discours anticoloniaux, mais à la capacité réelle des États africains à faire de l’Afrique un espace de droits, de protection et de dignité partagée pour ses propres citoyens.
Alan Basilegpo
📚 Référence principale
Suzanne Bonzon, Les Dahoméens en Afrique de l’Ouest, Revue française de science politique, vol. 17, n°4, 1967, p. 718-726. Article consultable sur Persée.