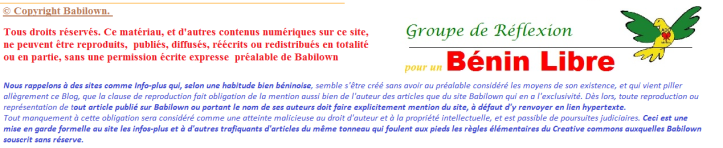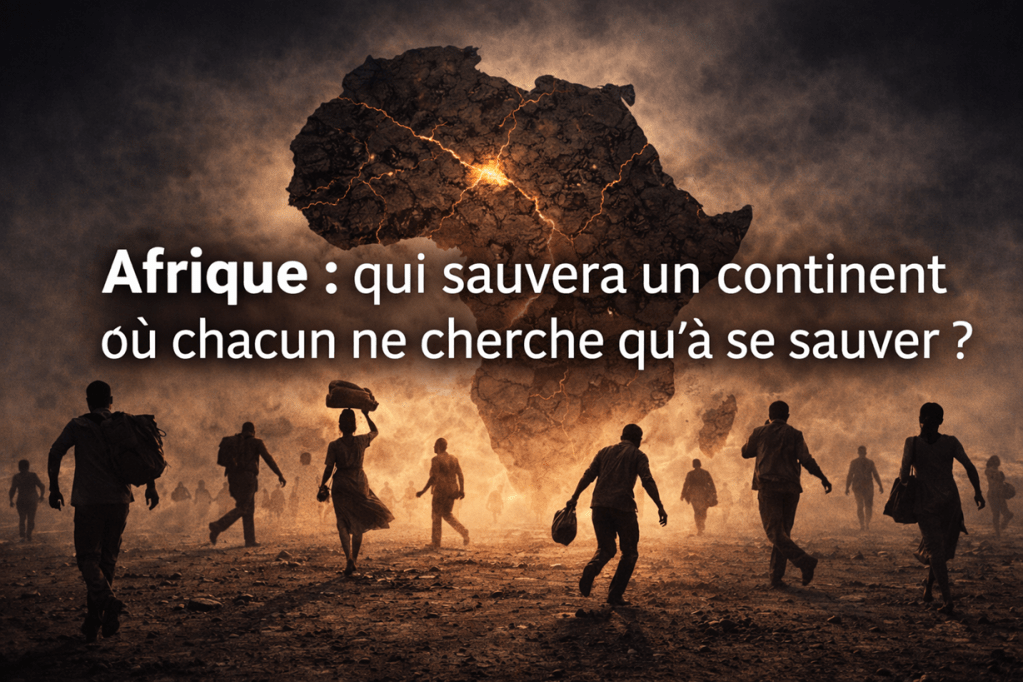
Dans Personne pour m’accompagner, Nadine Gordimer explore la solitude morale d’êtres confrontés à la fin d’un monde et à la difficulté d’en faire naître un autre. Le titre lui-même résonne comme une plainte sourde, presque universelle. Transposé à l’échelle d’un continent, il pourrait devenir cette formule terrible : Personne pour me sauver.
Si l’Afrique pouvait parler, c’est sans doute ce qu’elle dirait aujourd’hui. Non pas parce qu’elle manquerait de ressources, d’intelligences ou d’énergie humaine, mais parce qu’elle semble avoir perdu ce qui, partout ailleurs, rend le salut possible : la conviction intime qu’un destin collectif mérite d’être défendu, parfois au prix d’un renoncement individuel.
Aucune société ne survit lorsque ses membres cessent de croire à un destin commun. Plus précisément : aucune société ne tient lorsque plus personne n’est disposé à consentir le moindre sacrifice pour elle. L’Afrique contemporaine en offre aujourd’hui une illustration brutale.
À travers l’histoire des peuples, une constante s’impose. Les sociétés qui se sont maintenues, puis renforcées, sont celles dont les membres ont intégré une règle exigeante : la survie individuelle passe par la survie collective, et cette survie collective a toujours un coût. Qu’ils soient occidentaux ou asiatiques, individualistes ou conformistes, les peuples qui ont bâti des nations solides ont accepté une vérité inconfortable : il faut parfois renoncer à l’immédiat pour rendre possible le futur.
Le drame de l’Afrique est que l’Africain ne partage plus cet éthos.
L’Africain ne cherche pas à sauver sa communauté.
Il ne cherche pas à sauver sa nation.
Il ne cherche pas à sauver son État.
Il ne cherche même pas à sauver sa société.
Il cherche seulement à se sauver lui-même.
Ce repli radical sur l’individu n’est ni une stratégie transitoire ni un calcul rationnel temporaire. Il est l’expression d’un désengagement moral profond. Le collectif n’est plus perçu comme un héritage à préserver ou un projet à porter, mais comme une contrainte injuste. La nation n’est plus un horizon de sens ; elle devient une abstraction inutile. L’État n’est plus un bien commun à défendre ; il est soit une proie à exploiter, soit un espace à fuir.
Ce qui rend cette réalité particulièrement grave, c’est qu’elle ne concerne pas d’abord les élites politiques. Elle concerne l’Africain ordinaire. Le problème de l’Afrique n’est pas seulement que ses dirigeants la trahissent. Le problème est que l’Africain lambda ferait exactement la même chose s’il en avait l’occasion.
Si l’on offrait à n’importe quel Africain une somme suffisante pour garantir son confort à vie — chiffre symbolique, bien entendu — et que, pour l’obtenir, il lui fallait vendre l’Afrique tout entière, il accepterait. Sans hésiter. Sans négocier. Sans même se poser la question morale. Non par idéologie. Non par cruauté. Mais parce que l’idée même de préserver quelque chose au prix d’un renoncement personnel lui est devenue étrangère.
Cette disposition n’est pas théorique. Elle se manifeste depuis longtemps dans des domaines très concrets de la vie collective. Elle s’observe dans les choix économiques de court terme, dans la gestion des ressources naturelles, dans certaines orientations diplomatiques, mais aussi — et de manière particulièrement révélatrice — dans la question foncière. De vastes étendues de terres africaines ont été cédées, louées ou concédées à des groupes économiques étrangers, parfois pour des décennies, souvent sans véritable débat public ni souci du long terme. La terre, qui devrait être un héritage, une base de souveraineté et de transmission, est traitée comme une simple marchandise. Là encore, le même principe prévaut : mieux vaut un bénéfice immédiat qu’un avenir à préserver.
C’est ici que la question du sacrifice devient centrale.
Dans un tel état d’esprit, le sacrifice est un tabou. Pire encore : un oxymore éthique. L’idée de renoncer volontairement à une part de son confort, de ses opportunités ou de son bien-être immédiat au profit d’un avenir collectif est devenue incompréhensible, presque insultante. Or aucune nation ne s’est construite sans sacrifice. Aucune.
Partout ailleurs, des peuples ont accepté qu’une génération puisse devoir porter le poids pour que la suivante vive mieux. Une, parfois deux générations ont consenti à travailler davantage, à consommer moins, à différer leurs bénéfices, à endurer des conditions difficiles afin de rendre possible un futur commun. Ce n’est pas une exception historique : c’est la règle de toute construction durable.
Ne parlez pas de cela à l’Africain contemporain. Parlez-lui de sacrifice, et il vous regardera avec des yeux torves, l’écume au cœur. Il n’y verra ni noblesse ni responsabilité, mais une menace directe contre son salut individuel. Se sacrifier pour une société à laquelle il ne croit plus lui paraît non seulement inutile, mais irrationnel.
Le drame n’est pas l’absence de sacrifice en Afrique. Les sacrifices y sont quotidiens, massifs, souvent cruels. Le drame est ailleurs : dans la disparition de l’éthique du sacrifice. Le renoncement n’est plus perçu comme une vertu collective orientée vers l’avenir, mais comme une perte sèche, un effort inutile, une naïveté dangereuse. Dès lors, chacun sacrifie — mais uniquement pour lui-même, contre les autres, parfois contre le pays tout entier.
C’est cette disparition de l’éthique du sacrifice qui explique le reste. Elle éclaire la corruption banalisée, la prédation des ressources publiques, l’indifférence face à l’effondrement des institutions. Elle éclaire aussi la compulsion migratoire, non comme cause première, mais comme symptôme : lorsque plus personne n’est prêt à payer le prix du collectif, la fuite devient la seule option moralement acceptable.
Une société qui a perdu l’éthique du sacrifice a déjà renoncé au temps long. Elle vit dans l’instant, dans l’extraction maximale du présent. Elle ne prépare plus l’avenir ; elle le grignote. Elle ne transmet plus ; elle épuise.
Le problème africain n’est donc pas seulement économique, politique ou géopolitique. Il est fondamentalement moral. Et c’est précisément pour cette raison qu’il est si difficile à affronter. Car le discours moral, loin d’être entendu, est aujourd’hui massivement rejeté. Il est perçu comme une agression, une leçon déplacée, une tentative de culpabilisation. Toute exigence éthique est immédiatement disqualifiée, soupçonnée d’arrière-pensées ou tournée en dérision.
Dans ce climat, ceux qui osent encore parler de responsabilité, de renoncement, de devoir envers le collectif sont mal vus. On les accuse d’idéalisme, d’arrogance morale, parfois même de trahison. Ils dérangent parce qu’ils rappellent une dette que plus personne ne veut reconnaître. Leur parole heurte non parce qu’elle est fausse, mais parce qu’elle est coûteuse.
Pourtant, tant que l’Africain ne considérera pas la survie de sa communauté comme une condition préalable à la sienne, tant que le renoncement individuel sera perçu comme une bêtise et non comme une responsabilité, aucun projet de développement ne pourra durablement s’enraciner. On peut réformer les institutions, injecter des capitaux, changer les dirigeants ; sans socle moral partagé, tout effort restera superficiel et réversible.
On ne bâtit pas une nation sans sacrifice.
On ne sauve pas un peuple dont chaque membre n’a qu’une obsession : se sauver lui-même.
Alan Basilegpo