
C’est dans sa résidence dans le quartier de Godomey, à Cotonou, la capitale économique du Bénin, que John Igué nous a reçus en août et en décembre 2015. Près de cinq heures d’entretien ont permis d’aborder des questions aussi diverses que les relations anciennes entre le Bénin et le Nigeria ; les circonstances historiques du développement du commerce informel entre ces deux pays ; les premières années de l’université nationale au Bénin et sa politisation ; les pratiques politiques réelles et les contraintes d’une fonction ministérielle ; les failles du modèle démocratique béninois ; les options pour le développement économique en Afrique de l’Ouest…
Professeur de géographie à l’Université nationale du Bénin (actuelle Université d’Abomey-Calavi), ancien doyen de Faculté de cette université (1978-1981), John Igué a été ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises entre 1998 et 2001, dans un des gouvernements du président Mathieu Kérékou. Cette fonction politique n’a été qu’une parenthèse dans sa longue carrière.
Chercheur avant tout, passionné par la géographie économique mais aussi par l’histoire de la civilisation yoruba, l’économie informelle et la place de l’Afrique dans la mondialisation, il est à l’origine de la création du Laboratoire d’analyse régionale et d’expertise sociale (LARES), centre de recherche indépendant basé à Cotonou.
Il est l’auteur de plusieurs livres sur le Bénin et sur l’Afrique de l’Ouest et a contribué à d’autres travaux collectifs sur les questions de développement des pays africains (http://amzn.to/255YJZQ). Il a été, entre autres, conseiller du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE à Paris, directeur de l’Institut de l’Afrique de l’Ouest (IAO) basé à Praia au Cap-Vert et préside le Conseil d’administration du West Africa Civil Society Institute (WACSI), organisation dédiée au renforcement de la société civile basée à Accra (Ghana).
Retraité mais toujours actif et engagé, John Igué a un âge, 71 ans, où l’on peut prendre du recul pour faire le bilan de ses différentes tranches de vie, et partager ses expériences, ses certitudes, ses doutes, mais aussi ses frustrations et ses regrets avec les jeunes générations.
Allégresse Sassé et Gilles O. Yabi
Partie I: Être ministre au Bénin…
Comment devient-on ministre au Bénin?
On devient ministre par le jeu des lobbies. Tous les groupes constitués de la nation font pression sur le chef de l’Etat pour avoir leurs représentants au gouvernement. Ce n’est pas seulement au Bénin que cela se passe ainsi. C’est partout dans le monde. C’est pour cela que le président Nicéphore Soglo (président de 1991 à 1996) disait en son temps que quand il veut former un gouvernement, il perd du poids. L’arbitrage avec les lobbies est si dur qu’il perd beaucoup de poids.
Cet arbitrage intègre trois aspects : les différentes « sectes » qui ont des enjeux dans la nation, les différentes religions qui ont aussi des enjeux ; et les différentes régions du pays qui veulent que leurs fils assument de hautes fonctions. Donc, en fin de compte, la marge de manœuvre du chef de l’Etat devient faible.
On devient donc ministre par l’implication des lobbies, des religions, des sectes et des régions. C’est pour cela que beaucoup de gens veulent faire partie des sectes, des gens vont dans les églises aujourd’hui et les mosquées.
Une fois, quand j’étais au gouvernement, nous avons fait des aller-retour sur un dossier pendant près d’un mois. J’étais tellement désabusé que j’ai demandé au président de la République : « nous formons une équipe ou pas pour que sur le même dossier on perde autant de temps ?». Le président Kérékou m’a répondu : « C’est toi qui parles d’équipe. On n’est pas une équipe du tout, M. Igué. Telle personne, c’est celui-ci qui me l’a imposé. Telle autre personne, c’est tel groupe qui me l’a imposé». Et il me dit « On est 22. De ces 22, il n’y en a que trois qui m’appartiennent ».
On devient donc ministre par l’implication des lobbies, des religions, des sectes et des régions. C’est pour cela que beaucoup de gens veulent faire partie des sectes, des gens vont dans les églises aujourd’hui et les mosquées. C’est aussi pour cela que certains sont actifs dans leurs régions pour qu’on ne les oublie pas. La composition du gouvernement est faite à partir d’un arbitrage extrêmement serré entre ces différentes tendances. Par contre, il y a quelques rares cas de gens nommés sur la base des services qu’ils ont rendus à l’Etat. C’était mon cas. J’ai été nommé ministre sur la base des services que j’ai rendus à l’Etat.
Kérékou tenait coûte que coûte à me remercier pour ces services-là. Le premier de ces services que j’ai rendus, c’était en 1975 lorsque que le gouvernement voulait créer une monnaie nationale béninoise. Quand j’ai entendu cette rumeur, j’ai entrepris une étude que j’ai intitulée : « Contrebande et problèmes monétaires en Afrique de l’Ouest ». Quand j’ai eu le résultat de l’étude, j’ai organisé une conférence où j’ai dit publiquement que le projet de création d’une monnaie dans ce pays était une folie.
J’avais dit que cela n’avait aucun fondement économique solide et que nous allions connaître le même sort que la Guinée (qui était sortie de la zone CFA pour battre sa propre monnaie, sous le régime du nationaliste Sékou Touré). La majorité de ceux qui avaient suivi la conférence à l’époque était des policiers ou des « indics » de la Révolution (le Bénin était sous un régime révolutionnaire militaro-marxiste où le Bureau politique du parti unique était l’organe de décision le plus important). Des membres du Bureau politique sont venus me voir. Ils étaient au nombre de cinq et m’ont demandé pourquoi j’avais été si critique par rapport à la création de la monnaie.
J’ai fait le tableau de toutes les monnaies qui circulaient dans notre marché à l’époque, et expliqué pourquoi le Bénin, avec une masse monétaire de 3 milliards de francs CFA à l’époque, n’avait pas intérêt à créer sa propre monnaie. En un mois, le Nigeria pouvait acheter tous nos billets en échangeant des nairas (la monnaie nigériane). Dix milliards de nairas circulaient au Bénin à cause des avantages que présentait le franc CFA pour les opérateurs nigérians. Mes explications ont fini par convaincre les autorités qui ont enterré le projet de création de cette monnaie.
J’ai rendu un autre service à l’Etat béninois, pour dénouer une crise diplomatique avec les Etats-Unis, qui avaient fermé leur ambassade en 1978 (des soldats béninois avaient tiré par méprise sur des ressortissants américains dans les alentours du camp Guézo, camp militaire situé dans la ville de Cotonou). J’ai travaillé à la réouverture de cette ambassade en 1982. J’ai mis à profit toutes mes relations avec la communauté noire aux Etats-Unis sans informer qui que ce soit.
Je suis allé au Secrétariat d’Etat à Washington en 1982 sur la base d’une opportunité qui m’était offerte pour rencontrer la division Afrique et je leur ai demandé pourquoi ils avaient fermé leur ambassade à Cotonou. Je leur ai dit que notre pays n’avait pas d’intérêts à défendre sur la scène mondiale et que ce sont eux qui avaient des enjeux mondiaux.
Mon nom figurait parmi les membres du gouvernement qui avait été nommé après cet évènement. C’est entre le palais de la République et le siège de la télévision nationale qu’un membre du bureau politique a rayé mon nom. Comme Kérékou est un homme fin et calme, il n’a jamais protesté.
Les gens ont su plus tard que j’étais intervenu pour la réouverture de l’ambassade des Etats-Unis à Cotonou. Kérékou a noté cela. Il n’oubliait jamais rien. Le troisième point, c’est la convocation de la réunion concertée entre le Nigéria et le Bénin en mai 1988 pour régler les contentieux militaires qui existaient entre les deux Etats à cause des activités de contrebande. En 1984, le Nigeria avait fermé sa frontière unilatéralement. Et comme nous n’avions pas cessé les activités de contrebande, ils ont militarisé toute la frontière Est.
Je suis intervenu et j’ai utilisé mes relations au Nigeria pour proposer une réunion sur la coopération transfrontalière en mai 1988. Le vice-président du gouvernement fédéral du Nigeria et le vice-président du Bénin, se sont parlé à cette occasion. C’est cette conférence qui a permis de mettre fin au siège des militaires nigérians. Le message est parvenu au président Kérékou.
A la fin de cette conférence, le gouvernement a décidé de m’adresser des félicitations. Le président Kérékou disait que les félicitations ne suffisaient pas. Mon nom figurait parmi les membres du gouvernement qui avait été nommé après cet évènement. C’est entre le palais de la République et le siège de la télévision nationale qu’un membre du bureau politique a rayé mon nom. Comme Kérékou est un homme fin et calme, il n’a jamais protesté.
Il y a eu un quatrième service que j’ai rendu lorsque le gouvernement cherchait à revaloriser le prix du coton. Le LARES (le Laboratoire d’analyse régionale et d’expertise sociales créé à l’initiative du professeur Igué dont il a longtemps été le directeur scientifique) venait de finir une étude sur les coûts de production en agriculture dans quelques pays d’Afrique. Les résultats de cette étude ont permis de fournir des arguments aux bailleurs de fonds. C’est ainsi qu’on est arrivé à relever le prix de coton.
C’est pour me récompenser de toutes ces actions que Kérékou a décidé, sans qu’on ne se soit jamais vu, de me nommer ministre en mai 1998. 15 jours avant ma nomination, quand j’étais en train d’écrire mon livre sur « le Bénin et la mondialisation», je voulais une citation de Kérékou sur l’explication du changement de nom Dahomey en Bénin.
J’étais allé chercher ses discours au Palais quand un de ses collaborateurs proches m’a approché et m’a dit qu’on me cherchait depuis une semaine. Et il me dit « tu seras dans le prochain gouvernement. C’est moi que le président a choisi pour t’informer. Il m’a dit de ne pas demander ton avis». Le gouvernement a été formé et j’ai entendu mon nom. Donc, c’était une récompense personnelle décidée par Kérékou.
Quand on devient ministre, comment forme-t-on une équipe et comment gère-t-on un ministère?
Quand je suis arrivé, le premier geste que j’ai fait, c’est de réunir tout le personnel de mon ministère. Ils étaient au nombre de 550 dans un des amphithéâtres du ministère. C’est ainsi qu’est née en moi l’idée du gouvernement participatif. Je leur ai demandé comment ils voulaient que l’on procède pour la réorganisation du ministère. Cela a été une surprise générale. Ils m’ont dit que c’est la première fois depuis que le ministère existe que quelqu’un leur pose une telle question…
Pour gérer un ministère et avoir de bons résultats, il n’y a pas d’autres solutions que la participation. Si tu fais ton cabinet avec tes frères et tes parents en ignorant les autres, tu auras les pires ennuis du monde.
« Pour vous montrer ma bonne foi, je viendrai au ministère avec deux personnes. Le directeur de cabinet et le chargé des affaires administratives et financières. Tout le reste des postes vous appartient. Fournissez-moi trois noms par poste» leur avais-je-dit. Il y avait 15 postes dans le cabinet. Cela a duré trois mois avant qu’il ne dégage les trois noms. Mais cela a été ma victoire. Ils n’avaient jamais pensé que le ferais.
Pour gérer un ministère et avoir de bons résultats, il n’y a pas d’autres solutions que la participation. Si tu fais ton cabinet avec tes frères et tes parents en ignorant les autres, tu auras les pires ennuis du monde. Moi je n’ai pas connu cela. Il y encore des gens qui peuvent en témoigner au ministère. Je pense que les gens veulent qu’on les respecte.
J’ai hérité ce comportement de mon père. Quand on était jeune au village, si un de ses enfants se moquait de quelqu’un, mon père n’hésitait à le frapper. Et il disait : « Tant que quelqu’un a un souffle, quelles que soient ses conditions, il faut le respecter parce que le revirement de situation peut être spectaculaire. C’est celui qui est mort qui a terminé son histoire». Il nous frappait. Et il nous a aidés à nous débarrasser de notre complexe de supériorité.
Beaucoup de gens ont peur de gris-gris, de la sorcellerie. Ce sont des blocages liés à vos propres comportements. Si vous n’avez rien à vous reprocher, pourquoi auriez-vous peur de la sorcellerie? On ne peut quand même pas s’adonner à des actes de méchanceté de façon gratuite. Toute méchanceté est liée à une vengeance. C’est ma compréhension de la vie et cela m’a toujours aidé.
Partie II: Pour un développement et une démocratie qui cadrent avec ce que nous sommes
Comment impulser le développement économique d’un pays comme le Bénin ? Y a-t-il un modèle à suivre ?
L’erreur à ne pas commettre, c’est de vouloir imiter les autres. C’est une erreur parce que les contextes sociologiques et culturels n’étant pas les mêmes, vous n’aurez jamais les mêmes résultats. La voie à suivre est celle d’un développement qui s’adapte à ce que vous êtes et à ce que vous voulez être. Or, cette perception n’est pas partagée. Les gens sont toujours dans le discours ambiant. Or ce discours ambiant ne cadre pas avec nos réalités historiques et sociologiques. Qu’est-ce que vous allez obtenir? L’échec.
Le plus grand défi qui est posé aux pays africains et à mon pays le Bénin, c’est de réfléchir à un développement qui cadre avec ce que nous sommes. C’est absolument important. Quand on nous propose des orientations, nous devons dire que nous avons compris et que nous demandons le temps de réfléchir afin de faire nos contre-propositions. Ce que je dis, personne ne le fait aujourd’hui. C’est pour cela qu’on n’a pas de bons résultats. On se jette sur les propositions et des projets parce qu’il y a des opportunités de financement.
Je ne vois pas un gouvernement en Afrique aujourd’hui qui entre en dialogue avec ses populations pour s’enquérir des services dont elles ont besoin.
Ce sont ces opportunités de financement qui nous voilent la face. On prend l’argent, on s’endette, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et pour payer le service de la dette, on est obligé de s’endetter à nouveau. On est donc dans un cercle vicieux. Pour moi la solution est très simple. Je ne vois pas un gouvernement en Afrique aujourd’hui qui entre en dialogue avec ses populations pour s’enquérir des services dont elles ont besoin. On doit nécessairement commencer par ça. Si on faisait comme cela, on aurait énormément avancé. La première voie du développement, c’est la voie participative. Si on ne prend pas cette voie, les solutions qu’on choisira ne nous permettront pas de nous en sortir.
Deuxième chose, aucun des pays développés n’a fait le développement sur la base de l’initiative privée. C’est sur la base de l’initiative des pouvoirs publics. Or, on nous propose l’inverse. Cela ne marchera jamais. Il faudrait qu’on s’assure d’abord qu’il existe un secteur privé qui est capable de relayer l’Etat ici. On a complètement inversé l’approche. Et ce que ça donne aujourd’hui, c’est qu’on n’a plus d’initiative aussi bien au niveau du secteur privé qu’au niveau des pouvoirs publics.
Aucun des pays développés n’a fait le développement sur la base de l’initiative privée.
Il faut revenir en arrière parce qu’il y a des secteurs de développement que le privé ne peut jamais embrasser parce que l’argent personnel est différent de celui des contribuables. J’ai été le président du Conseil d’administration d’une Banque au Bénin. Quand je suis arrivé à la banque, j’ai fait le bilan du personnel, j’ai constaté que 70% du personnel étaient des enfants des actionnaires. Cela veut dire que le marché du travail n’était pas ouvert. Les enfants des actionnaires n’ayant pas les compétences requises et sachant que la banque appartient à leurs pères, ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient.
J’ai appelé les actionnaires pour leur faire comprendre les problèmes qu’ils ont créés eux-mêmes. Je leur ai proposé de négocier. Ils se sont opposés à ma demande en arguant qu’ils avaient investi pour sécuriser l’avenir de leur descendance. C’est cela la réalité du secteur privé que nous voulons coûte que coûte promouvoir. Ce secteur privé n’est pas aussi propre qu’on le pense. Les secteurs privés dans nos pays n’ont pas encore les moyens pour amorcer le développement à l’exception du Nigeria. Ils n’ont pas les moyens et ils ne sont pas non plus organisés.
Pour moi, le développement doit être récupéré par l’Etat à partir d’un programme de développement participatif. Comme on n’a pas beaucoup de moyens, parce qu’avec un tel modèle de développement, ce n’est pas sûr qu’on ait l’adhésion des bailleurs de fonds, nous devons être très modeste dans nos prévisions. Mais malheureusement, on fait « le fourre-tout ». Vous êtes pauvres et vous voulez faire tout, quel développement voulez-vous obtenir? Il faut changer complètement d’orientation.
Les secteurs privés dans nos pays n’ont pas encore les moyens pour amorcer le développement à l’exception du Nigeria.
Il faut qu’on se spécialise. On ne doit pas faire la même chose que nos voisins. L’économie de prédation imposée par la colonisation consiste à rendre le prix des produits attractif pour le pays qui les achète. Et on nous pousse à faire la même chose. Tout le monde cultive le coton, l’arachide… Et quand la production est abondante, il y a la mévente et les prix chutent. Il nous faut aller nécessairement vers la spécialisation.
Quand le président Yayi Boni a été élu, il a promis de porter la production cotonnière à 600 000 tonnes. Est-ce qu’il a réussi? Il n’a pas réussi parce qu’avant de faire cette déclaration, il n’a pas interrogé d’abord les producteurs sur les raisons pour lesquelles on était passé de 400 000 à 200 000 tonnes quand il est arrivé. Il avait fait ces déclarations sous le coup de l’émotion. Ce sont des erreurs énormes…
Vous préconisez le retour de l’Etat. Mais l’Etat est corrompu…
Vous savez, si vous raisonnez comme cela, vous n’allez pas structurer l’Etat. L’Etat par essence n’est pas corrompu. Ce sont les hommes qui sont dans l’Etat qui sont corrompus. Et je veux rappeler ce que le président Obama a dit à ses homologues africains : « Ayez des institutions fortes». Et c’est bien cela. Il faut travailler à ce que les institutions soient fortes. C’est cela d’abord l’Etat.
C’est le mode de gestion de l’Etat qui fait que les gens sont cupides.
Ensuite, il y a les hommes. Mais tous les hommes ne peuvent pas être cupides. C’est le mode de gestion de l’Etat qui fait que les gens sont cupides. Si la démocratie fonctionnait comme elle devrait, on ne devrait pas connaître de détournements de fonds publics. Nous sommes dans un système de démocratie accaparée aujourd’hui.
Vous préconisez une démocratie participative. Comment devons-nous y arriver ?
La démocratie classique ne marche pas. Prenez par exemple les cas du Rwanda et du Burundi. Les anciens chefs d’hier sont toujours une minorité au sein de la population. Donc si vous faites la démocratie, les majorités gagneront toujours contre les minorités qui étaient hier les dirigeants. Donc au Burundi et au Rwanda, ce ne sont pas les élections qui vont régler les problèmes. C’est l’arbitrage. Il n’y a pas que le Burundi et le Rwanda qui vivent cette situation.
Nous avons aussi le Nigeria qui est frappé par le tribalisme. Si on fait des élections démocratiques, ce sont les Haoussa qui choisiront toujours les présidents de la République parce qu’ils sont plus nombreux que les autres. Que deviendront les Ibo, les Yorouba et les autres groupes dans ce système? Ça veut dire que les élections mécaniques ne règleront jamais les problèmes du Nigeria, du Rwanda et du Burundi. Il faut donc trouver une autre forme de démocratie. Peut-être avec une rotation du pouvoir fondée sur des négociations.
Les élections mécaniques ne règleront jamais les problèmes du Nigeria, du Rwanda et du Burundi.
Les accords d’Arusha ont ramené la paix au Burundi. Ces accords recommandent le respect de minorités et demandent de leur trouver une manière de participer à l’exercice du pouvoir. Quand ils ont mis cela en application, ça a marché. Mais comme Nkurunziza a mis fin à ces accords, on voit ce que cela crée.
Nous devons dire à l’Occident ce qui nous intéresse dans la démocratie. Nous voulons renforcer notre solidarité. On doit choisir la démocratie participative et consensuelle. Ce qu’on fait aujourd’hui n’est pas adapté à nos sociétés. On a des ébauches de solution à nos problèmes. Le rôle de la culture et de l’histoire est vraiment important. Je pense que la société mondiale ne peut faire son développement de façon unitaire. Il faut revenir à l’identité des gens.
Partie III: Le lourd tribut payé par l’université béninoise à la politisation et au mimétisme culturel
Souvenirs des premières années de l’université au Bénin
Ma carrière à l’Université nationale du Bénin reste une période très importante pour moi. Je fais partie des membres fondateurs de cette université et j’ai eu le privilège d’être parmi les trois personnes qui ont créé la Faculté des lettres en 1971. J’étais le premier Béninois encadré par deux Françaises.
Quand les deux Françaises sont parties, c’est moi qui ai eu à structurer la maison en faisant venir mes aînés parmi lesquels il y avait Alfred Mondjanagni, Karl Emmanuel, Jean Pliya et Honorat Aguessy. Quand ces aînés sont arrivés, je me suis retiré pour leur laisser la direction de la faculté. J’étais un peu découragé par le conflit de personnes entre certains de ces aînés…
J’ai été obligé de m’éclipser pour me faire inviter par l’Université d’Ifè du Nigeria en 1977 comme chercheur visiteur sur le programme de la diaspora Yoruba en Afrique de l’Ouest francophone. J’étais en train d’exécuter cette mission quand un rapport a été produit sur moi par le gouvernement révolutionnaire de l’époque (le régime militaro-marxiste de Mathieu Kérékou, note de WATHI).
Le rapport indiquait que j’avais fui le pays. Les enquêtes avaient démontré le contraire. Mais il s’est passé un incident qui a été déterminant pour moi. J’ai eu beaucoup de succès quand j’étais à Ifè comme chercheur en visite. Au cours de mes enquêtes, j’étais allé en Côte d’Ivoire. J’ai fait un exposé à mes collègues ivoiriens à la demande de mes collègues géographes sur la situation de la main d’œuvre en Afrique de l’Ouest et particulièrement sur les enjeux de la migration.
Cet exposé a tellement marqué les Ivoiriens que le lendemain il avait fait la une du quotidien Fraternité Matin. Et au même moment, il se tenait un congrès du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), auquel des Béninois étaient invités. Ceux qui ont vu ma photo et le titre de mon intervention ont acheté les journaux et sont allés voir le gouvernement révolutionnaire pour leur montrer que j’étais vraiment parti. Pour eux, si les Ivoiriens avaient pu écrire sur moi, c’est parce que j’avais été acheté.
Réseaux mafieux et manipulations politiques des étudiants
C’est pour vérifier que j’étais effectivement parti en exil qu’ils m’ont nommé doyen de la Faculté des Lettres à l’Université nationale du Bénin sans me consulter. Je suis rentré en 1978 pour prendre le poste. C’est quand j’ai pris ce poste de doyen que je me suis rendu compte des enjeux. J’ai eu du succès en assumant cette fonction de doyen pendant trois ans. Cela m’a permis de restructurer l’université, d’écarter un peu les vieux qui étaient dans leurs querelles pour recruter de nouveaux jeunes, croyant qu’en faisant venir du sang nouveau au sein de la Faculté, cela allait améliorer les choses.
Mais malheureusement, je ne savais pas que la société était organisée en réseaux mafieux non transparents et qu’elle ne reposait pas sur les qualifications universitaires. Comme je n’étais membre d’aucun de ces réseaux, je croyais que tout fonctionnait à partir de la transparence et des compétences. Mais ce n’était pas le cas. Tous ces jeunes-là étaient inféodés à des réseaux et cela a fait que l’espoir que je plaçais en eux a été déçu.
Les militaires qui ne voulaient pas partir du pouvoir ont organisé les étudiants pour mener des actions extrêmement violentes contre le régime révolutionnaire et montrer ainsi au président Kérékou qu’on ne pouvait pas changer le gouvernement dans une situation de crise.
Toujours est-il qu’on a eu des difficultés. La fin de mon mandat à la tête de la faculté correspondait au passage du gouvernement militaire au gouvernement civil en 1981. Les militaires qui ne voulaient pas partir du pouvoir ont organisé les étudiants pour mener des actions extrêmement violentes contre le régime révolutionnaire et montrer ainsi au président Kérékou qu’on ne pouvait pas changer le gouvernement dans une situation de crise.
Pendant cette période de troubles, les hautes autorités de l’université ont abandonné l’université et trouvé des prétextes pour partir dans des missions de longue durée. Et c’est dans ce contexte qu’on m’a nommé intérimaire du recteur. On m’a nommé et le deuxième jour, la crise a commencé.
J’ai eu l’habilité de convoquer très tôt tous les étudiants qui étaient à l’origine de cette crise pour dire qu’on ne fait pas de revendications quand les « titulaires de la maison » ne sont pas là. Comme j’étais apprécié en tant qu’enseignant et même en tant que doyen, j’ai pu casser l’unité du mouvement. Le caractère violent qu’on voulait donner à ce mouvement a été brisé.
Puis j’ai surpris des militaires en train de faire des réunions avec des étudiants. Et j’ai fait un rapport au gouvernement pour expliquer que c’étaient les militaires qui soutenaient les mouvements estudiantins. J’ai cité les noms des officiers que j’avais surpris avec des étudiants. Le bureau politique a pris rapidement des mesures contre ces militaires. Et cela a précipité la formation du gouvernement civil et l’arrêt des mouvements estudiantins.
Mais j’ai réussi à faire une chose qui a été pour moi un grand succès : les militaires quand ils étaient aux affaires, pour aggraver la situation, m’ont proposé de militariser l’université pour la sauver, mais j’avais refusé, en tant qu’ancien militant révolutionnaire. Je ne pouvais jamais autoriser la banalisation du campus par l’arrivée des militaires. Pour sauver le campus, j’ai demandé à tous les doyens d’y aller dormir afin d’empêcher l’arrivée des militaires. Cela a beaucoup plu au bureau politique du parti révolutionnaire. Après, ils ont décidé de me nommer comme recteur.
Politisation de l’université et sacrifice de la formation et de la recherche
Au moment où la décision allait être prise, des gens du Nord ont dit qu’ils étaient intéressés par la récupération de l’université et qu’il faut qu’ils viennent négocier avec moi avant qu’on ne me nomme. C’est ainsi que j’ai reçu quelques cadres du Nord dans mon bureau. Et je leur ai dit que si c’était pour me manipuler, je n’étais plus intéressé par le poste.
Je suis allé voir les autorités du ministère de l’Education pour leur annoncer que je n’étais plus intéressé par le décanat. Je leur ai suggéré de ne plus nommer politiquement les doyens et de mettre en place un système d’élections.
C’est comme cela que je n’ai plus été nommé recteur. Tous ces incidents m’ont fait énormément mûrir et m’ont permis de me retirer de la scène politique parce que pour moi, cela ne permettait pas de faire du bien au pays tellement les calculs d’intérêts sont importants. C’est comme ça que je me suis refugié dans la recherche. Je suis allé voir les autorités du ministère de l’Education pour leur annoncer que je n’étais plus intéressé par le décanat. Je leur ai suggéré de ne plus nommer politiquement les doyens et de mettre en place un système d’élections.
L’idée, c’est de permettre aux doyens d’avoir plus d’autorité sur leurs collègues et sur les étudiants. Et cette suggestion a été approuvée par le gouvernement parce qu’il avait une très bonne impression de moi. Ils ont accepté la réforme et ils croyaient que j’allais poser ma candidature. Cela m’a permis de la retirer élégamment. Mais cet incident m’a fait réfléchir sur l’avenir de l’université par rapport à deux choses : les enjeux de la recherche et la nécessité de refuser la politisation du campus universitaire.
C’est pour vous montrer que les problèmes que nous rencontrons à l’université aujourd’hui ont leurs origines dans ces circonstances anciennes. L’Université nationale du Bénin a été réduite à un terrain politique à cause de l’enjeu que représente la colonie des étudiants, des étudiants que tout le monde voulait avoir avec soi. L’université a souffert grandement de l’instabilité des responsables à la tête du rectorat. Tous les deux ans, on changeait de recteur. Cela a fait que cette université n’a pas eu une très grande réputation scientifique jusqu’à aujourd’hui, à l’exception de la Faculté de Médecine.
La politisation du campus a porté un grand coup à la qualité de la formation et de la recherche scientifique.
La politisation du campus a porté un grand coup à la qualité de la formation et de la recherche scientifique. Ceux qui ont réussi à construire une réputation, ce sont ceux qui ont quitté le jeu politique. Moi, en faisant mon choix, je me suis concentré sur mes activités scientifiques en publiant régulièrement les résultats de mes recherches. Et les résultats sont là aujourd’hui. C’est cela qui est à l’origine de la création de mon laboratoire (Le Laboratoire d’analyse régionale et d’expertise sociale, LARES).
Les structures qui ont été mises en place très tôt après l’indépendance pour promouvoir ce pays n’ont pas fonctionné. Au lieu d’être le centre de rayonnement de la nation, l’université est restée d’abord un enjeu politique. Et quand on voit aujourd’hui comment les choses se passent dans le pays, on se demande s’il y existe vraiment de véritables compétences.
Conditions matérielles des professeurs et sous-dimensionnement de l’université
Les professeurs étaient payés par la France. La première génération des professeurs était très bien traitée matériellement. Pendant que le salaire moyen des fonctionnaires était entre 50 000 francs CFA (de l’époque) et 60 000 FCFA, celui des professeurs d’université était autour de 250 000 FCFA. Donc il n’y avait pas de problèmes matériels.
L’université avait été créée pour 1000 étudiants au maximum. Dès la première année de son fonctionnement, il y avait 10 000 étudiants.
La France a garanti la sécurité matérielle des professeurs pendant dix ans. Et les étudiants étaient boursiers. Par contre, le seul problème, c’est qu’on avait minimisé la dimension de l’université. L’université avait été créée pour 1000 étudiants au maximum. Dès la première année de son fonctionnement, il y avait 10 000 étudiants. Et ce problème est resté jusqu’à aujourd’hui. Le sous-dimensionnement des infrastructures universitaires reste un réel problème.
Différences marquantes entre les universités nigérianes et l’université nationale du Bénin
Les premières universités au Nigeria sont apparues depuis 1948, même avant l’université de Dakar au Sénégal (1957). C’est l’exemple des universités d’Ibadan (créée en 1948) ou de Nsukka (1955). Ce sont de ces vieilles universités que sont nées les universités de deuxième génération au Nigeria. Ile-Ifè fait partie des universités de deuxième génération qui ont émergé dans le cadre d’un combat régional.
Les Haoussa (ou Hausa) avaient créé l’université Ahmadu Bello à Zaria au nord du pays. Les Yoruba ont voulu avoir aussi la leur en créant une université à Ilé-Ifè. Et les Ibo (ou Igbo) se sont accaparés de l’Université de Nsukka. Ibadan est restée une université neutre. Dans cette deuxième génération, le gouvernement fédéral de l’époque a récupéré Ahmadu Bello en la transformant en une université fédérale. Il a aussi créé l’université de Lagos.
On se battait pour la promotion de la civilisation yoruba. Un centre y a même été consacré. Dans ce centre, on traduisait tous les documents scientifiques en langue yoruba.
Ilé-Ifè et Nsukka sont restées des universités régionales. Autour d’Ilé-Ifè s’est constitué un lobby puissant fait de grands nationalistes nigérians yoruba sous la houlette d’Obafemi Awolowo (Premier ministre de la Région de l’Ouest et un des artisans de l’indépendance du Nigeria). C’est ainsi que l’Université d’Ifè a su mobiliser les fonds nécessaires à son fonctionnement. Elle a surtout mobilisé les cadres yoruba de très haut niveau qui en ont fait une université de très grande réputation scientifique.
C’est dans cette ambiance que je suis allé là-bas. On se battait pour la promotion de la civilisation yoruba. Un centre y a même été consacré. Dans ce centre, on traduisait tous les documents scientifiques en langue yoruba. Et on voulait diffuser la langue yoruba comme langue de culture. Le recteur avait su réunir autour de lui des équipes solides et définir des objectifs précis.
C’est un dynamisme qu’on ne sentait pas à l’Université nationale du Bénin. Cette expérience nigériane m’intéressait beaucoup parce que j’avais de très bonnes relations avec les chercheurs. En tant que Yoruba, je voulais me faire la main en me rapprochant de mes frères yoruba du Nigeria. Et l’expérience a très bien marché. De cette expérience, j’ai même écrit un livre (Les Yoruba en Afrique de l’Ouest francophone / The Yoruba in French-speaking West Africa).
Nationalisme culturel assumé d’un côté, absence d’identité propre de l’autre
On avait des objectifs bien précis. Ma présence à Ifè n’était pas fortuite. Avant d’aller à Ifè, j’avais publié avec Olabiyi Yaï, (qui fut plus tard et pendant longtemps ambassadeur du Bénin à l’UNESCO), un article sur les Yoruba hors du Nigeria. Cet article a permis aux Yoruba du Nigeria de savoir que l’aire culturelle yoruba était beaucoup plus importante que ce qu’ils en savaient. C’est pour cela qu’ils se sont rapprochés de nous deux pour nous récupérer très tôt et travailler ensemble à l’unité de la civilisation yoruba.
Ce n’était pas un carcan. Nous avions plutôt des objectifs précis parce qu’une université pour se différencier d’une autre a besoin d’un programme particulier. Notre programme à l’université d’Ifè, c’était la promotion de la civilisation yoruba. C’était une conviction.
Notre université au Bénin n’est pas centrée sur la culture béninoise. On ne connaît pas son objectif, ni ses orientations fondamentales. Or, aujourd’hui, nous avons besoin d’affirmer notre personnalité en tant que Béninois tant dans la région ouest-africaine que dans le monde. C’est cela le rôle de l’université.
Notre université au Bénin n’est pas centrée sur la culture béninoise. On ne connaît pas son objectif, ni ses orientations fondamentales.
Que représente le peuple Adja-fon? Que représente le peuple Bariba? Que représentent les peuples de l’Atacora? Et ce combat, on devrait le mener en ayant pour objectif la construction de la nation béninoise autour des solidarités inter-ethniques. On devrait aussi faire le diagnostic de ce qu’est le Bénin par rapport aux autres Etats.
On a connu ici trois évolutions par rapport auxquelles l’université aurait dû se prononcer. La première évolution, c’est la crise des coups d’Etat répétés depuis l’indépendance jusqu’à la constitution du gouvernement que l’on a nommé « le monstre à trois têtes » (un système de rotation à la tête de l’Etat de trois personnalités représentant trois grandes régions du pays dans les premières années après l’indépendance). On devrait pouvoir savoir ce que cela a apporté au pays. La deuxième phase, c’est la période révolutionnaire. La troisième phase, c’est celle dite du renouveau démocratique.
L’université n’a apporté aucune contribution à la compréhension de ces trois phases-là. Or ces trois phases déterminent l’évolution de la nation béninoise. On est resté dans le discours ambiant imposé par le système international sans réfléchir profondément à ce que nous sommes et à nos blocages. C’est pour cela que notre progrès est resté très mitigé.
La spécialisation des universités a produit le nationalisme au Nigéria. Et elle a produit aujourd’hui Nollywood, l’industrie du cinéma nigérian.
Les universitaires nigérians sont très nationalistes. La spécialisation des universités a produit le nationalisme au Nigéria. Et elle a produit aujourd’hui Nollywood, l’industrie du cinéma nigérian. Nollywood n’est pas venu ex nihilo, c’est le résultat d’un long processus. Ils font cinquante films par semaine. C’est énorme. Ils le font à la fois en pays Ibo, en pays Haoussa et en pays Yoruba.
Wole Soyinka, prix Nobel de la Littérature (1986), est de l’université d’Ifè. Il a bénéficié de tout le support de la civilisation yoruba pour écrire ses différents romans. Cette orientation fondée sur une culture a des résultats spectaculaires. Et aujourd’hui, cela continue. Tous les « pays » yoruba, environ une dizaine d’Etats de la fédération, montrent une solidarité sans faille à cause de cela. Or ici au Bénin, nos communes ne peuvent même pas être solidaires bien qu’émanant d’une même ère culturelle. Parce qu’il n’y a pas de soubassement théorique.
Nos penseurs font le relais de la civilisation française. C’est pour cela que cela ne marche pas. Il faut penser à une organisation interne basée sur nos cultures. Sans cela, nous n’apporterons rien à la civilisation mondiale. Nous ne pourrons que répéter ce que font les autres. C’est cela, le problème de fond aujourd’hui.
Partie IV: Le passé, le présent et le futur des relations entre le Bénin et Nigéria
La guerre du Biafra et ses conséquences positives sur l’économie béninoise
Avant la guerre du Biafra, le Bénin (ex-Dahomey, note de WATHI) était l’enfant malade de l’Afrique. Ce sont les effets positifs de la guerre du Biafra qui ont permis à la révolution (sous le régime militaro-marxiste de Mathieu Kérékou, note de WATHI) de résister pendant 17 ans. Ce qui fait l’économie béninoise aujourd’hui, ce sont les activités de réexportation inventées en 1973 par la révolution. C’est pour cela que notre révolution n’a pas été marquée par la pénurie. C’était une révolution d’abondance. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Pendant la révolution, on a connu des taux de croissance allant jusqu’à 11%.
Très peu de pays africains ayant fait la révolution ont connu cela. C’est pour cela que contrairement à ce qu’on dit de la révolution, il y a eu des choses très positives. Et ce sont les conséquences de la guerre du Biafra. Ces conséquences de la guerre du Biafra que j’étais le seul à analyser à l’époque m’ont orienté sur le plan de la recherche académique vers la géographie économique.
Pendant la guerre du Biafra, l’économie du Nigeria était bloquée. Pour faire fonctionner son économie, le Nigeria a joué sur la solidarité de ses voisins qui avaient refusé de reconnaître la sécession biafraise. Le marché du cacao du Nigeria qui était l’un des poumons des Etats de l’Ouest était bloqué. C’est par le Bénin que les producteurs nigérians ont pu organiser la poursuite des activités de cette filière. C’est en faisant le commerce du cacao avec le Nigeria que nous avons retrouvé les ressources nécessaires pour équilibrer notre balance de paiements pour la première fois.
Comment le Bénin a-t-il continué à profiter de la situation géographique du Nigéria?
Les relations avec le Nigéria ne sont pas liées seulement à la guerre du Biafra. Ce sont des relations anciennes. Tout le Bénin, du nord au sud, constitue les appendices des grands groupes culturels dont l’origine se trouve au Nigeria. Tous les Yorouba du monde entier se réclament d’Ilé Ifè, comme étant leur maison mère. Ces Yorouba sont à la fois importants au Bénin, mais aussi au Togo et au Ghana.
Du point de vue numérique, à part la population Adja-Fon, c’est la population d’origine Yorouba qui est la plus importante au Bénin. De plus, dans le cadre de la traite des esclaves qui a duré quatre siècles dans ce pays, il y a eu d’énormes brassages entres les Yorouba et les populations d’origine Adja-Fon à tel point que toute la population du Bénin méridional est une population métissée.
Ces liens anciens sont à l’origine de ce que nous faisons aujourd’hui avec le Nigéria. Ces liens sont restés extrêmement profonds. Nous les avons monnayés pendant la période coloniale sous forme de contrebande traditionnelle fondée sur les produits prohibés par la Grande-Bretagne au Nigeria ainsi que ceux interdits par la France au Dahomey. Par exemple dans la colonie française, vous ne pouviez pas faire le commerce des armes et de la poudre à canon. Au Nigeria, le commerce de l’alcool n’était pas répandu.
Avant la guerre du Biafra, les échanges reposaient sur des conventions. Ce que le Bénin fournissait au Nigeria d’important, c’était l’huile de palme et les dérivés ainsi que le poisson pêché dans le lac Nokoué (situé dans le sud du pays). A l’époque, ce lac était l’un des plus riches en tilapias du monde. Nous ravitaillions également les industries de brasserie du Nigeria en maïs. Et on leur apportait aussi de l’alcool. En contrepartie, le Nigeria nous fournissait essentiellement des bicyclettes et leurs pièces. Le Nigéria nous fournissait aussi de la poudre à canon et des armes à feu.
Les relations étaient vraiment intenses. Mais cela se faisait sous forme de contrebande. C’est à cause de l’intensité de cette contrebande que pendant la colonisation, entre la côte et le nord du Bénin, il y avait 32 postes de douane sur le cordon frontalier. A l’indépendance, on a réduit le nombre de postes. Mais cette activité a été amplifiée avec la guerre du Biafra.
De très grandes communautés marchandes se sont installées dans des villes comme Porto-Novo. En 1920, sur 50 000 habitants que comptait Porto-Novo, les Yorouba étaient 32 000. Ce sont eux qui faisaient Porto-Novo à l’époque. Leur enracinement ne date pas d’aujourd’hui. Ce sont eux qui ont fait l’économie de la ville de Porto-Novo jusqu’à aujourd’hui.
C’est sur des recherches de ce genre que l’université devrait travailler. Aujourd’hui, je ne peux pas vous dire quels sont les axes fondamentaux de recherche de l’université. Or les créneaux sont là. C’est pour cela que j’ai dit que l’université n’a pas travaillé sur la société béninoise.
Au-delà de l’ère culturelle yorouba, d’autres acteurs et groupes culturels sont-ils historiquement impliqués dans les relations entre le Bénin et le Nigeria ?
Après la guerre du Biafra, les Ibo (ou Igbo, groupe majoritaire du sud-est du Nigeria) se sont impliqués à tel point que Cotonou est devenu la ville des échanges financiers de la diaspora ibo dans le monde aujourd’hui. C’est surtout à cause des avantages du franc CFA. Ces Ibo sont devenus des acteurs extrêmement puissants dans les relations entre le Bénin et le Nigeria. Et c’est grâce à eux d’ailleurs que les banques nigérianes se sont installées dans ce pays depuis quelques années de façon aussi forte.
Cotonou est devenu la ville des échanges financiers de la diaspora ibo dans le monde aujourd’hui.
Ils ont amené ici une activité qu’on ne connaissait pas au départ : la friperie (vente de vêtements, chaussures et accessoires usagés importés des pays occidentaux). A la friperie se sont ajoutées beaucoup d’autres activités comme la vente des matériels électroniques. Les Ibo sont devenus importants et dynamiques. Et ce sont eux et non les Yorouba du Nigeria qui sont derrière tous les achats de terrains qui se font depuis la frontière du Nigeria jusqu’à Cotonou aujourd’hui.
Dans dix ans, comment entrevoyez-vous l’avenir des Ibo du Nigéria au Bénin?
Il n’y a pas de ville de 1000 habitants au Bénin où vous n’avez pas une boutique d’Ibo aujourd’hui. Ils ont une organisation d’occupation de l’espace très remarquable. Mais on n’a aucune réaction face à cela. Cela veut dire qu’à terme, le Nigeria risque de nous récupérer dans l’essentiel de ce que nous sommes aujourd’hui. Il faut qu’on s’y prépare. On dit aujourd’hui que le Bénin est le 37ème Etat du Nigéria. A terme, cela peut devenir une réalité.
Il n’y a pas de ville de 1000 habitants au Bénin où vous n’avez pas une boutique d’Ibo aujourd’hui.
De toutes les façons, l’Etat fédéré de Lagos seul est plus peuplé que l’Etat béninois. Que pouvez-vous faire face à cela? Ils sont actuellement en train de construire de Lagos jusqu’à Badagry (ville située côté nigérian près de la frontière) une voie qui sera la première de l’Afrique de l’Ouest avec cinq voies dans chaque direction, avec au milieu une voie pour un tramway.
Quand ils ont commencé, je suis allé voir les maires de Cotonou et de Sémè-Podji (ville du sud-est du Bénin) pour leur demander les dispositions que le Bénin prend pour faire face à cette perspective. Quand cette infrastructure routière sera construite, nous serons les faubourgs immédiats de Lagos. Ils n’ont pas compris les enjeux. Ils n’avaient pas réagi. Quand l’infrastructure sera construite, nous serons un quartier de Lagos.
Quand cette infrastructure routière sera construite, nous serons les faubourgs immédiats de Lagos.
Il y a beaucoup de choses qui se passent au Nigéria qui ne sont pas favorables à l’autonomisation de notre pays. Mais comme on ne réfléchit pas sur le long terme, cela ne nous dit rien. Au Bénin, tout le monde s’habille déjà comme les habitants de Lagos. La seule chose qui diffère, c’est la langue. Après, cela viendra. Les P-Square (groupe de musique populaire nigérian dont le succès est mondial) ont détrôné la musique noire américaine aujourd’hui dans la région. Et le phénomène Nollywood (http://bit.ly/1Lae1zP) a détrôné le cinéma mexicain.
Pensez-vous que dans dix ans, les Nigérians pourront influencer la désignation du chef de l’Etat béninois?
Ce n’est pas dans dix ans. C’est la stratégie actuelle. Les Nigérians disent que pour diminuer l’influence de la France dans la zone francophone, la seule solution est de contrôler la prochaine génération de chefs d’Etat. La France a déjà compris cela.
Les Nigérians disent que pour diminuer l’influence de la France dans la zone francophone, la seule solution est de contrôler la prochaine génération de chefs d’Etat.
C’est une affaire de moyens financiers. Vous savez, certains candidats à l’élection présidentielle au Bénin étaient tous les week-ends au Nigeria. Ce qui a arrêté ce mouvement, ce fut le changement de régime au Nigeria avec l’arrivée de Muhammadu Buhari et la période longue d’installation de son pouvoir. C’est cela qui a arrêté l’élan des grands ambitieux béninois vers le Nigeria. Les élections, c’est une affaire de gros sous. Or pour les lobbies nigérians, ce que nous appelons gros sous ici au Bénin ne représentent pas grand-chose.
Vu la taille du Nigeria et celle du Bénin, sans être phagocyté par le Nigeria, le Bénin peut-il se projeter lui-même?
Le Nigeria que nous considérons ici comme un pays de voyous, est très organisé parce qu’ils ont des structures qui font des études stratégiques. Le Nigeria Institute of International Affairs est le support de la diplomatie nigériane. Aucun ministre des Affaires étrangères au Nigeria ne peut rien faire sans se référer à leurs analyses. Ils ont quelques autres centres de recherche qui sont incontournables dans le parcours de tous les grands responsables publics. Ces centres sont axés sur la réflexion stratégique.
Le Nigeria que nous considérons ici comme un pays de voyous, est très organisé parce qu’ils ont des structures qui font des études stratégiques.
La preuve, c’est le Nigeria Institute of International Affairs qui a affirmé à travers un ouvrage qu’en Afrique de l’Ouest, il n’y a que deux puissances, la France et le Nigeria. Personne ne peut contester cela. Pour ce centre, on ne peut pas négocier avec les pays francophones. C’est avec Paris qu’il faut négocier quand on veut négocier avec les pays francophones.
Ici au Bénin, existe-t-il une structure qui fait des études stratégiques ? C’est la différence. C’est pourquoi je dis que l’université ne s’assume pas par rapport à son rôle dans la nation. C’est profond, ce que je vous dis. La réalité est là. On n’a pas une vision de ce que nous voulons devenir. Celui qui réfléchit aura toujours la victoire sur celui qui dort. C’est la loi de la nature. Au Bénin, il n’y a personne pour animer le débat sur les vrais enjeux. Et il n’y a pas d’organisation.
Celui qui réfléchit aura toujours la victoire sur celui qui dort. C’est la loi de la nature.
Les Sénégalais sont dans presque toutes les institutions internationales aujourd’hui. Sans une organisation, cela ne pouvait pas arriver. Or à l’indépendance, c’est nous (les Béninois) qui occupions actuellement la position qu’occupent les Sénégalais aujourd’hui. Mais comme on n’a pas fait d’efforts pour nous organiser, les Sénégalais et les Burkinabès sont venus nous déloger. Si vous comptez le nombre des Béninois qui occupent des positions fortes dans les institutions internationales aujourd’hui, vous n’en trouverez pas beaucoup. C’est la différence entre ceux qui s’organisent et ceux qui ne le font pas.
Nous avons détruit l’héritage révolutionnaire. Depuis le renouveau démocratique, on est dans la cacophonie permanente.
C’est sur les mauvais comportements que nous nous sommes organisés ici. Les réseaux mafieux de détournement fonctionnent bien ici. Mais est-ce l’avenir? Au Bénin, personne n’est préoccupé par une construction durable. On est pressé de s’enrichir. Et on ne sait pas ce qu’on fait avec l’argent accumulé.
Nous avons détruit l’héritage révolutionnaire. Depuis le renouveau démocratique, on est dans la cacophonie permanente. On ne sait vraiment pas où on va. Et cette cacophonie a un impact très négatif sur l’organisation politique. Avec 150 partis politiques, que peut-on avoir comme société? On a compris le multipartisme intégral de façon négative. A chaque élection présidentielle, on a de trop nombreux candidats. Que peut-on obtenir avec cela? La nécessité de réorganiser la société béninoise est devenue une urgence.
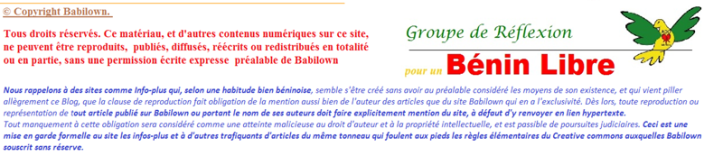
Bonjour,
Véritable Odyssée socio-économique et politique qu’est cette interview donnée par le professeur Igué J. Une fois de plus, Igué donne la preuve de son expertise plurielle sur le passé et le présent, voire le futur des politiques bénino-nigeriannes. Cette interview doit être rendue plus publique afin que, sans complexe ni fioriture, les dirigeants béninois au plus haut niveau, voire tout autre citoyen, puissent y tirer tous les enseignements indéniables à l’existence du Bénin ainsi qu’à son émergence.
Bien amicalement
Merci de dire tout haut ce que je pense à peine tout bas !