
Introduction
« Si vous voulez cacher une vérité à l’Africain, mettez-la dans un livre. »
— boutade populaire
On sourit d’abord. Mais très vite, le rire se fige, tant cette formule dit crûment une réalité préoccupante : l’écrit, en Afrique, peine encore à séduire. Ce n’est pas qu’il soit absent — il existe, circule, s’impose parfois à l’école ou dans l’administration —, mais il n’est pas habité, investi, aimé. L’Africain a toujours mieux à faire que de lire.
Or, l’écrit n’est pas une simple technique. Les sciences humaines l’ont abondamment montré, de Jack Goody à Walter Ong : il transforme la pensée. Lire et écrire, c’est prendre du recul, mettre les émotions à distance, vérifier un argument, transmettre fidèlement un savoir au-delà du temps et de l’espace. C’est aussi permettre l’abstraction, la philosophie, la science, l’accumulation des connaissances. Là où l’oralité valorise l’immédiat et le collectif, l’écrit offre à une société la capacité de se projeter dans la longue durée et de se libérer de la mémoire fragile des hommes.
Dans une vision souvent euphorique, beaucoup — et pas seulement des Africains — prophétisent que le XXIᵉ siècle sera celui du « réveil de l’Afrique », comme le XXᵉ fut, tour à tour, celui de l’essor des « dragons » d’Asie du Sud-Est, du Japon, de la Corée, de la Chine, mais aussi de l’Inde et de l’Indonésie. Ces prophéties à courte vue, comme il en fleurit fréquemment en Afrique, sont d’autant plus accueillies avec ferveur qu’elles bénéficient de l’appui flagorneur de certains idéologues occidentaux, opportunistes et souvent imbus d’eux-mêmes.
Mais la véritable question est la suivante : dans l’histoire, combien de civilisations, de nations ou d’États ont connu une prospérité durable et une puissance réelle sans s’être adossés à une civilisation de l’écrit ?
L’évidence saute aux yeux, surtout si l’on considère les siècles et décennies récents. Le Japon, la Chine, la Corée, l’Inde : toutes puisent leur dynamisme dans des traditions écrites solides, où l’écriture structure la pensée, le droit, la mémoire et l’organisation sociale. Il en est de même pour la Russie et pour l’Europe, qu’elle soit envisagée dans son format restreint ou élargi. Même en Afrique, les grands empires — du Mali, du Ghana — ou des cités prestigieuses comme Tombouctou ont bâti leur rayonnement et consolidé leur prospérité à l’ombre d’une véritable culture de l’écrit.
Si l’on remonte plus loin encore, l’exemple est tout aussi clair : l’Égypte pharaonique, la Mésopotamie, Rome elle-même — toutes ces puissances ont puisé leur essence dans une civilisation de l’écrit qui leur a donné cohésion, mémoire et projection historique.
Et pourtant, dans une euphorie déconcertante — pour ne pas dire puérile —, combien de fois n’a-t-on pas entendu des Africains comparer le Sénégal et la Corée ? L’indignation fuse : comment expliquer que le premier soit resté pauvre alors que la seconde est devenue prospère, alors que, quelques décennies auparavant, ces deux pays affichaient un niveau similaire de pauvreté, avec même un certain avantage pour le Sénégal ? Poser la question en ces termes naïfs, c’est faire l’impasse sur les conditions infrastructurelles, cognitives et symboliques qui sous-tendent le développement des sociétés humaines.
Voilà pourquoi, avant de rêver d’un « siècle africain », il est urgent d’interroger le rapport de l’Afrique contemporaine à l’écrit et à la lecture. Car c’est là que se joue, silencieusement mais décisivement, la capacité d’un peuple à se penser lui-même, à accumuler des savoirs et à se projeter dans l’avenir.
Or, quand on observe les pratiques culturelles et sociales actuelles, un constat s’impose : la lecture reste marginale, presque secondaire. Une vidéo, un message vocal, une discussion animée attirent des foules ; un texte écrit, même sur le même sujet, ne séduit qu’une poignée de lecteurs. Cette disproportion, révélatrice, dit beaucoup de l’héritage historique et des logiques profondes qui maintiennent encore l’oralité en position dominante sur le continent.
C’est précisément ce qui fait problème en Afrique : l’écrit n’a pas encore trouvé toute sa place dans les pratiques sociales et culturelles.
1) Constats et exemples
Le constat est simple, presque banal. Une vidéo postée en ligne attire des centaines de spectateurs en une heure. Un fichier audio, le même succès. Mais que ce contenu soit proposé sous forme écrite, et il ne récoltera qu’une poignée de lecteurs dans toute la journée.
Même dans les relations intimes, ce désintérêt se vérifie. Écrire une lettre à ses proches, même instruits, suscite souvent l’incompréhension ou l’agacement, comme si l’on n’avait rien fait d’utile. Mais décrocher le téléphone suffit à rétablir la chaleur du lien. L’oral circule, fédère, réchauffe. L’écrit, lui, reste perçu comme froid, contraignant, étranger.
2) Causes historiques et culturelles
Pour comprendre cette situation, il faut remonter loin dans l’histoire. Sur le continent africain, les formes de transmission du savoir ont été multiples. Si certaines régions, comme la vallée du Nil ou le royaume d’Aksoum, ont développé très tôt des traditions écrites, une grande partie des sociétés africaines ont privilégié, pendant des siècles, l’oralité comme mode principal de conservation et de partage des connaissances. La mémoire collective, la parole du sage, le récit du griot y jouaient un rôle central, là où, dans d’autres contextes, l’écriture occupait une place plus dominante.
Cette habitude a façonné des comportements et une manière d’être au monde : l’écrit y est perçu comme solitaire, presque inhumain, tandis que la parole immédiate incarne la vie et le partage. Mais là réside un paradoxe : s’il n’y a pas d’écrivains, il ne peut y avoir de lecteurs. La chaîne de transmission est rompue avant même d’avoir commencé.
3) L’héritage de la colonisation
À ce poids historique s’ajoute l’impact décisif de la colonisation, qui a aggravé cette fracture. Elle a imposé des langues étrangères comme unique vecteur de savoir et de reconnaissance sociale. Lire et écrire se sont retrouvés enfermés dans l’espace scolaire : il fallait rédiger pour réussir un examen, pour obtenir un diplôme, pour franchir un concours. Hors de ce cadre utilitaire, l’écrit n’avait plus de sens.
Quant aux langues africaines, elles furent reléguées à l’oralité, confinées à la sphère domestique et intime. Résultat : une forme de « paresse symbolique » s’est installée. Les efforts pour élaborer une pensée écrite dans les langues locales, les moderniser, en faire des instruments de savoir et de création, sont restés trop rares. Et l’absence de volonté politique dans ce domaine a prolongé une dépendance culturelle lourde de conséquences.
4) L’inadéquation culturelle de la lecture
Cette situation a engendré un paradoxe : le concept même de « littérature africaine » écrite dans des langues qui ne sont pas africaines – la « littérature francophone », par exemple – est, en réalité, une construction artificielle. Maintenu et promu par des institutions comme l’Organisation internationale de la Francophonie, il ne survit que dans l’atmosphère aliénée d’une Afrique postcoloniale encore largement marquée par le néocolonialisme. Il s’agit, en fin de compte, d’un non-sens : une littérature détachée de ses racines et étrangère à son propre terreau culturel.
La littérature est d’abord et avant tout un miroir de l’imaginaire d’un peuple. Elle reflète une langue, un terroir, une histoire, une nature et une culture qui la nourrissent et la structurent. Elle ne peut se réduire à un exercice d’érudition ou à une démonstration de culture. Et pourtant, combien d’Africains instruits, désireux de briller par leur savoir, citent Victor Hugo, Rousseau ou d’autres figures de la littérature européenne classique, sans se rendre compte qu’ils convoquent des fantômes d’un passé qui ne leur appartient plus ? Ces auteurs, admirables dans leur contexte historique, relèvent de l’histoire littéraire plutôt que de la littérature vivante, capable de dialoguer avec les réalités contemporaines de l’Afrique.
La littérature, pour exister, exige des médiations symboliques. Les écrivains, les artistes et les lecteurs sont liés par un réseau invisible de sens, de références et d’échos qui traversent le temps et l’espace. Mais ces échos ne résonnent que dans un ordre culturel précis. Transplantée dans un contexte étranger, une œuvre perd une part essentielle de sa vitalité et devient difficilement lisible ou compréhensible par ceux qui vivent dans un autre univers culturel.
C’est ici qu’émerge l’un des paradoxes de l’Afrique contemporaine : beaucoup de ses habitants ne lisent pas, non par manque d’intelligence ou de curiosité, mais parce que leur pulsion lectorale se trouve suspendue dans le vide. Les livres qu’on leur propose ne parlent pas à leur expérience, ne reflètent pas leur réalité tangible et manquent de racines dans leur monde. La lecture, pour être vivante et génératrice de sens, doit dialoguer avec des imaginaires et des langues africaines, s’enraciner dans des histoires, des paysages et des cultures qui résonnent véritablement.
Une littérature africaine authentique ne peut se contenter de recopier des modèles étrangers. Elle doit se nourrir de ses propres langues, de ses propres récits, de sa mémoire collective et de ses préoccupations contemporaines. Ce n’est que lorsqu’elle sera capable de prendre racine dans le vécu africain, tout en dialoguant avec le monde, qu’elle redeviendra une littérature vivante, capable d’inspirer, de mobiliser et de transformer.
L’Afrique doit cesser d’être un simple spectateur des littératures importées et retrouver la maîtrise de sa voix, de son verbe et de son imaginaire. Car la littérature véritable n’est pas un héritage à exhiber, mais un souffle vivant qui prend corps dans les mots, les langues et les histoires de ceux qui la font naître.
5) Facteurs psychologiques
À ce poids historique et politique s’ajoute une dimension psychologique. Beaucoup d’Africains semblent avoir intériorisé l’idée que réfléchir en profondeur, théoriser, philosopher, n’est pas leur affaire. La pensée est jugée utile seulement lorsqu’elle est instrumentale : préparer un diplôme, réussir un concours, accéder à un emploi.
En dehors de ce cadre, réfléchir paraît suspect, inutile, parfois même risible. La lecture, qui exige une discipline solitaire, un effort abstrait, une durée qui dépasse l’immédiat, se trouve désertée. On lit volontiers pour s’indigner, pour suivre l’actualité politique, pour nourrir des échanges passionnés — mais rarement pour construire une réflexion durable.
6) Le piège des langues
Le rapport aux langues joue ici un rôle décisif. Les langues occidentales, devenues langues de l’école et du savoir officiel, exercent un monopole excessif sur la connaissance. Mais elles ne s’intègrent pas naturellement dans la vie quotidienne, dans les échanges affectifs ou culturels. Elles fonctionnent comme des outils administratifs ou scolaires, mais peinent à devenir des vecteurs intimes de pensée et de création.
Or, le goût de la lecture est instinctif : il naît de la langue maternelle, celle qui a porté les premières expériences sensibles. Lire dans sa propre langue, c’est retrouver un rythme, des images, une chaleur qui donnent envie de poursuivre. Mais lorsque la lecture doit se faire dans une langue étrangère, acquise à l’école, dépourvue de cette résonance affective, elle devient un exercice froid, une obligation. C’est ainsi que l’Africain se retrouve dans un désert symbolique : l’écrit existe, mais il ne parle pas son langage, ne reflète pas ses références, n’évoque pas ses mondes.
7) Le carcan scolaire
Cette situation est aggravée par le système éducatif lui-même. Le savoir a été enfermé dans des langues étrangères et dans une logique de concours et de diplômes. On lit et on écrit pour « réussir », pas pour comprendre ni pour se construire. Une fois les épreuves passées, la lecture redevient inutile, presque encombrante.
On n’est jamais vraiment à l’aise que dans sa langue maternelle. Or, l’école a fait de cette langue un handicap, une faiblesse, un vestige à oublier. Résultat : l’étudiant se retrouve coincé. D’un côté, il ne lit pas spontanément dans sa langue maternelle, puisqu’elle est dévalorisée et rarement écrite ; de l’autre, il ne trouve pas de plaisir durable à lire dans une langue étrangère, puisqu’elle est artificielle et réduite à une fonction utilitaire.
8) La marginalisation des langues africaines
Dans un monde dominé par l’écrit, avoir cantonné les langues africaines à l’oralité équivaut à les condamner. Car une langue qui ne s’écrit pas est une langue que l’on appauvrit, que l’on enferme dans l’immédiat, que l’on prive de mémoire. L’oralité, aussi riche soit-elle, ne peut pas accumuler ni transmettre à la même échelle que l’écrit. Elle ne laisse pas de traces durables, elle ne permet pas la vérification, elle ne favorise pas l’argumentation longue. En privant les langues africaines de ce support, on les a fragilisées et vouées à une lente disparition.
9) L’ironie des nouvelles technologies
Et pourtant, un retournement inattendu s’esquisse. Les nouvelles technologies redonnent une vitalité spectaculaire à l’oralité. Les réseaux sociaux, la vidéo, le podcast, les messages vocaux, les échanges instantanés valorisent la voix et l’image. Là où l’école avait marginalisé les langues africaines, le numérique les ressuscite. On les entend à nouveau dans la sphère publique, on les partage, on les diffuse à grande échelle.
C’est un paradoxe ironique : ce que l’imprimé avait refusé aux langues africaines, l’ère numérique semble le leur rendre. Mais cette revanche de l’oralité n’efface pas la question fondamentale : sans lecture, sans appropriation de l’écrit, l’Afrique reste dépendante des autres pour la mise en forme durable de sa pensée. Car la vérité est implacable : on ne bâtit pas une civilisation moderne sur des vidéos et des rumeurs. On la construit sur des textes.
Conclusion : écrire pour ne plus subir
On disait qu’il suffisait de mettre une vérité dans un livre pour la cacher à l’Africain. Mais le véritable enjeu est aujourd’hui de faire mentir cette boutade. Cela suppose de réconcilier les Africains avec l’écrit, non pas en niant l’importance de l’oralité, mais en donnant aux langues africaines une dignité scripturaire et littéraire.
Car lire, c’est bien plus qu’un acte scolaire : c’est apprendre à réfléchir par soi-même, à vérifier, à douter, à critiquer. C’est aussi transmettre une mémoire commune et affirmer une dignité culturelle. Là où l’écrit manque, la pensée reste prisonnière de l’instant, vulnérable à l’oubli et à la manipulation. Là où il renaît, il donne à une société les moyens de se projeter dans l’avenir.
L’Afrique n’a pas seulement besoin de consommateurs d’images et de paroles éphémères ; elle a besoin de lecteurs capables d’inscrire leur pensée dans le temps long. Faire aimer la lecture, c’est faire aimer la liberté. Et c’est sans doute la condition pour que l’Afrique cesse de subir son histoire et commence véritablement à l’écrire.
Alan Basilegpo
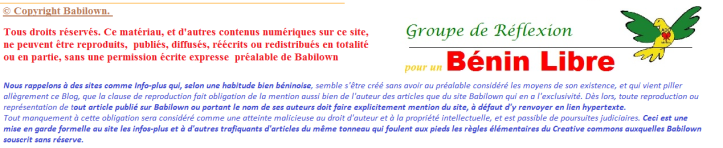
« On n’est jamais vraiment à l’aise que dans sa langue maternelle » Cette vérité nous poursuit, s’impose par moments dans des circonstances spécifiques alors que l’on croit avoir, que l’on a la maîtrise fine d’une langue non maternelle.